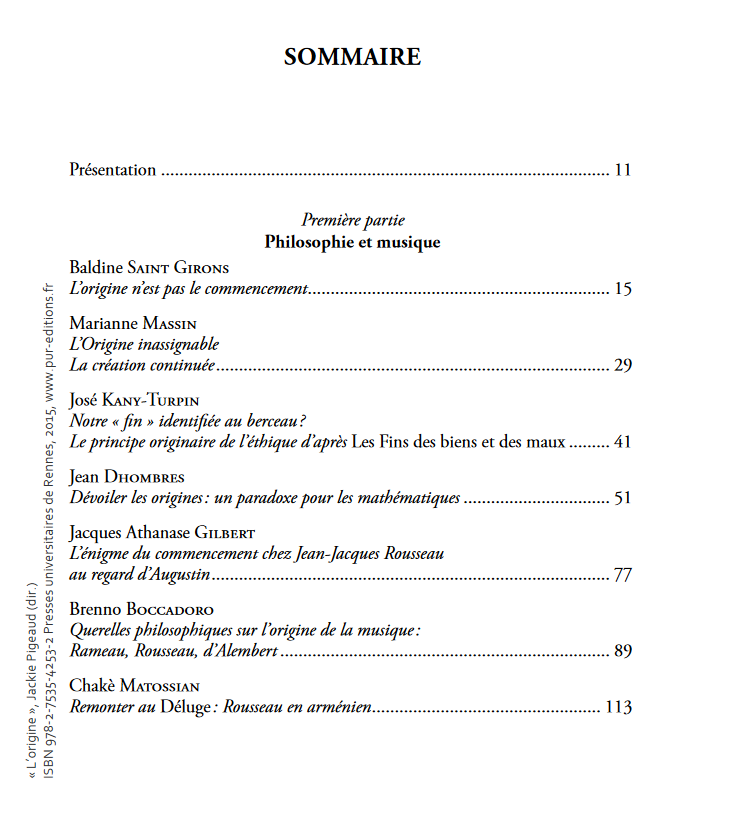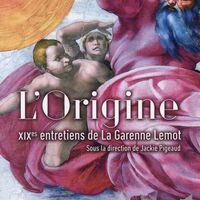XIX. L'Origine.
- Titre
- XIX. L'Origine.
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2015
- Description
-
Nous sommes écartelés, un pied dans l'originaire, l'autre dans un temps qui se retire inéluctablement. L'idée d'origine n'est-elle qu'un mythe et sa sensation un leurre ? à quoi servent la remontée au principe et la déconnexion de l'ici-maintenant qu'elle opère ? Si l'origine libère du commencement, on s'aperçoit des équivoques auxquelles elle conduit, telles que l'idolâtrie du prétendu fondement, «l'obsession embryogénique» ou la quête naïve de «précurseurs».
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"De la prise de conscience des rythmes poétiques qui nous dirigent et de notre aptitude à les modifier plus ou moins, nous en sommes venus à la question de l’origine : pourquoi et comment un retour en arrière est-il nécessaire ? « On tient la source, l’origine, quand on a trouvé une définition et qui soit considérée comme telle dans l’histoire ». Il faut se garder de toute interprétation intempestive et partir d’une « définition paratactique », comme l’appelle Jackie. Ainsi nous faut-il poser simultanément un certain état de la bile noire et un comportement, sans préjuger de liens de cause à effet. Comment traduire 'phobia' et 'disthymia' dans le "Corpus hippocratique", VI, 23 : « Si la 'phobia' et la 'disthymia' durent longtemps, un tel état a affaire à la bile noire. » ? Ne faisons pas trop vite de 'phobia' et 'disthymia' des passions de l’âme, telles que crainte et tristesse. Tenons-les, au contraire, pour de simples comportements, tels que « retrait » et « abattement », en nous situant avant la fameuse bipartition entre passions de l’âme et maladies du corps.
L’avantage qu’on trouve à en revenir à l’origine en développant une pensée en amont, c’est de comprendre à la fois la spécificité et l’arbitraire des voies historiquement suivies. Pareille poétique se fonde sur une philosophie qui tient compte des passages et du renversement possible des extrêmes l’un dans l’autre et de la coïncidence des opposés, à la manière de Nicolas de Cues. Même si nos Entretiens ont continué à privilégier dans leurs titres un terme unique, souvent pris à la fois au singulier et au pluriel, la présence des couples de contraires y est devenue de plus en plus sensible. De fait, l’éveil suppose le sommeil, l’intérieur s’abouche à l’extérieur, et la connaissance de soi se relie à un sentiment viscéral de soi. Et, de l’autre côté, l’extérieur, le sommeil, la sensation viscérale – termes souvent oubliés, méconnus ou refoulés – se renversent également dans l’intérieur, l’éveil, la connaissance de soi. Il s’agit d’un jeu de forces qui ne cesse de se recomposer. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.170"| - Format
-
- 416 pages
- 22 interventions
_________________ -
Philosophie et Musique
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « L'origine n'est pas le commencement », p. 15-28.
- Marianne Massin, Université de Paris IV-Sorbonne (philosophie) : « L’origine inassignable. La recréation continuée », p. 29-39.
- José Kany-Turpin, professeur émérite, Université de Paris 12 (latin) : « Notre ‘fin’ identifiée au berceau ? Le principe originaire de l’éthique d’après les "Fins des biens et des maux", p. 41-50.
- Jean Dhombres, Centre KOYRE, EHEES, Paris (histoire de mathématiques) : « Dévoiler les origines : un paradoxe pour les mathématiques », p. 51-75.
- Jacques Athanase Gilbert, Université de Nantes (littérature comparée) : « L’énigme du commencement chez Jean-Jacques Rousseau au regard d’Augustin », p. 77-87.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « Querelles philosophiques sur l’origine de la musique : Rameau, Rousseau, d’Alembert », p. 89-111.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie – histoire de l’art) : « Remonter au Déluge : Rousseau en habit arménien », p. 113-130.
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France (membre junior honoraire), Université de Nantes, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « L’origine comme principe tautologique ? », p. 131-141.
_________________
Art et Littérature
_________________
- Romain Pigeaud, Institut de paléontologie (chercheur associé), directeur éditorial d’Errance (Actes Sud) : « L'origine de l'art et de la culture », p. 145-186.
- Etienne Wolff, Université de Paris 10 Nanterre (latin) : « L'origine de la merveille médiévale de la statue suspendue », p. 187-195.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV Sorbonne (histoire de l’art contemporain) : « Esthétique kaléidoscopique et origine », p. 197-226.
- Clélia Nau, Université de Paris 8 (philosophie) : « L’écho de l’origine. "Narcissus redivivus" de Nicolas Poussin à Cy Twombly », p. 227-251.
- Pierre Henri Frangne, Université de Rennes (philosophie) : « Origine du paysage, paysage de l’origine : peinture et photographie », p. 253-269.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Traumas, rêves, images. Scènes du crime (en histoire) et de l’origine (au cinéma), p. 271-291.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « Lever de rideau sur la pièce "Yerma" de Federico García Lorca : ou l’art dramatique achevé du dévoilement du conflit originel », p. 293-305.
_________________
Histoire et Politique
_________________
- François Clément, Université de Nantes (littérature arabe) ; CRHIA (EA 1163, Nantes) ; CESCM (UMR CNRS 6223, Poitiers) : « Sâ‘id l'Andalou et l'origine des nations », p. 309-318.
- Nicole Dhombres, historienne : « 1651, "Leviathan. Let us make man...”, p. 319-329.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « Nicolas-Antoine Boulanger et l’origine du despotisme asiatique », p. 331-350.
_________________
Poésie et Poétique
_________________
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (esthétique) : « L’aède autodidacte et l’origine de l’originalité poétique », p. 353-364.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris 3-Sorbonne nouvelle (littérature latine) : « Aux origines du poème – quelques remarques sur les conceptions de Virgile », p.365-371.
- Françoise Graziani, Université de Corte (philosophie) : « L’origine du nom de poète selon Boccace», p. 373-386.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Retour à Ossian », p. 387-394.
Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, membre senior honoraire, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature classique, histoire de la pensée médicale) : « L’origine de la mélancolie », p. 395-414
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, du conseil général de Loire-Atlantique, du conseil régional des Pays-de-la-Loire, et de la mairie de Nantes.
- Pages du site
- Consulter les Entretiens (ouvrages)
Ressources liées
Fait partie de XIX. L'Origine.