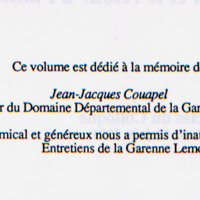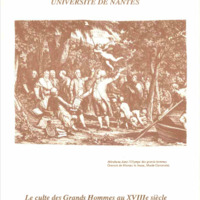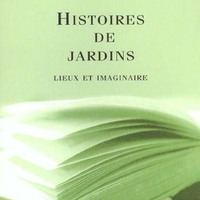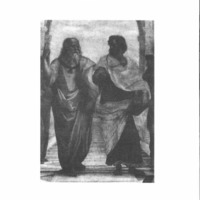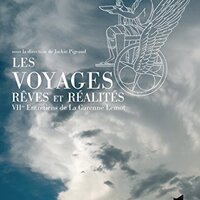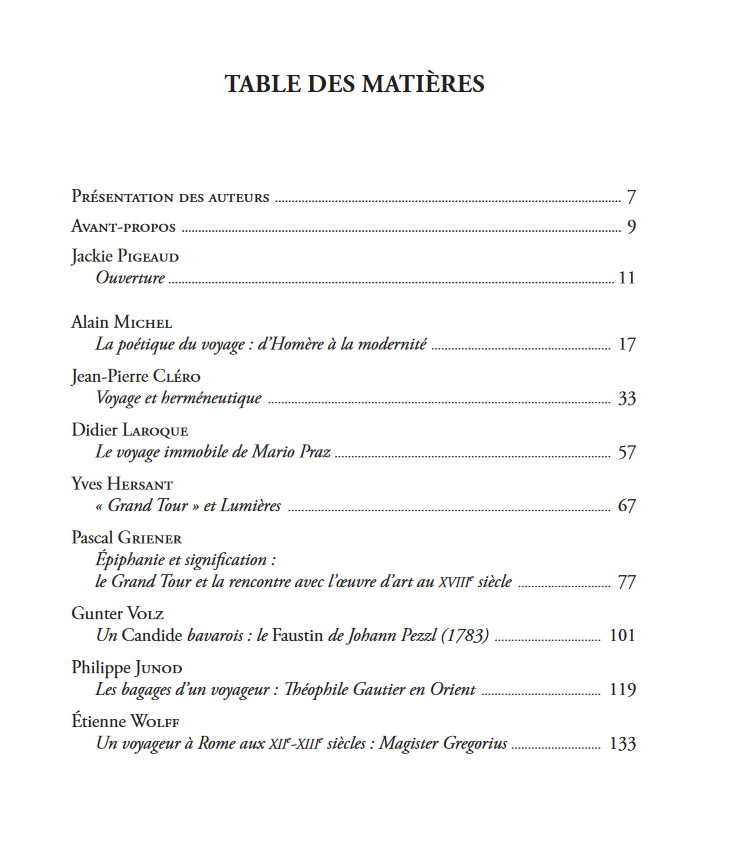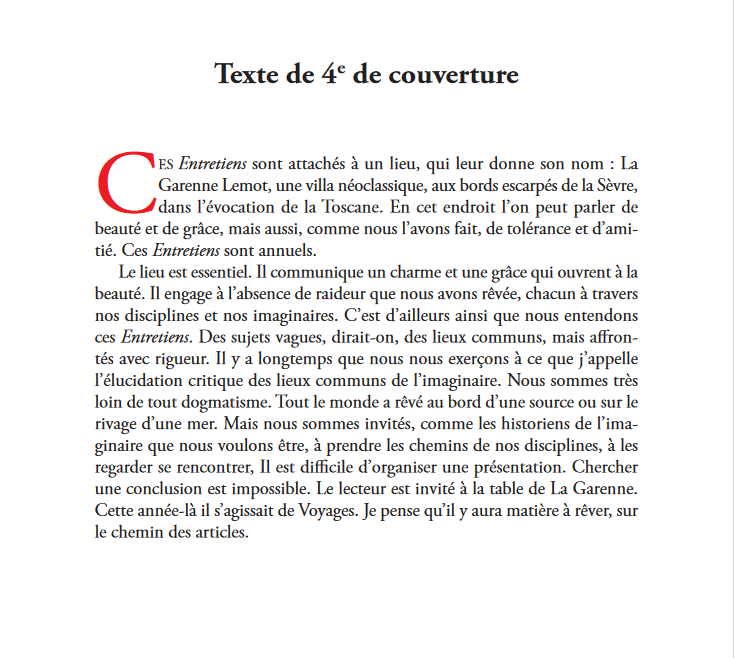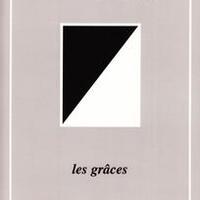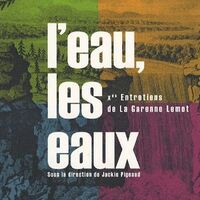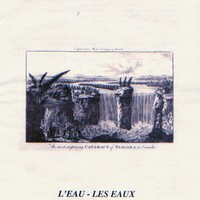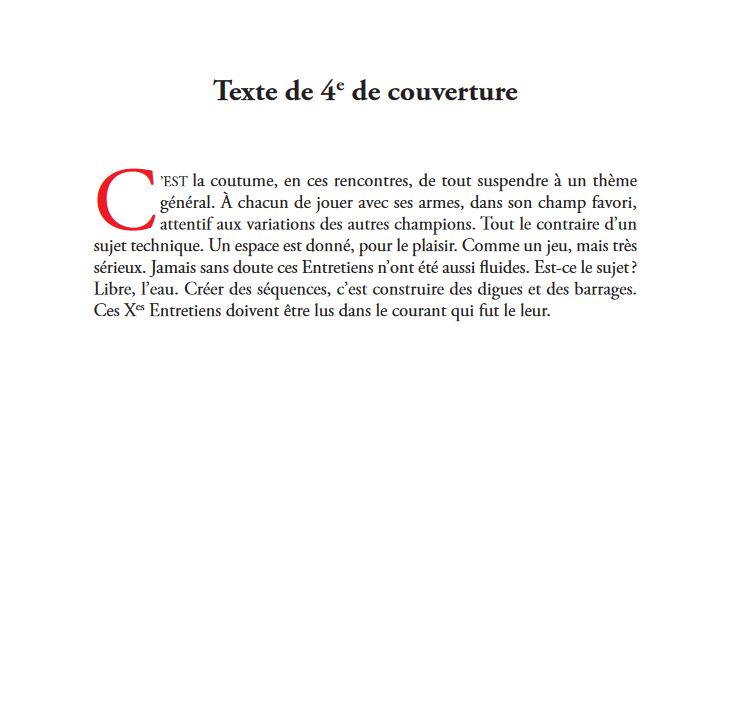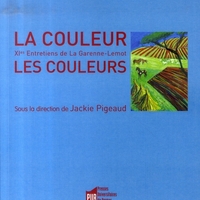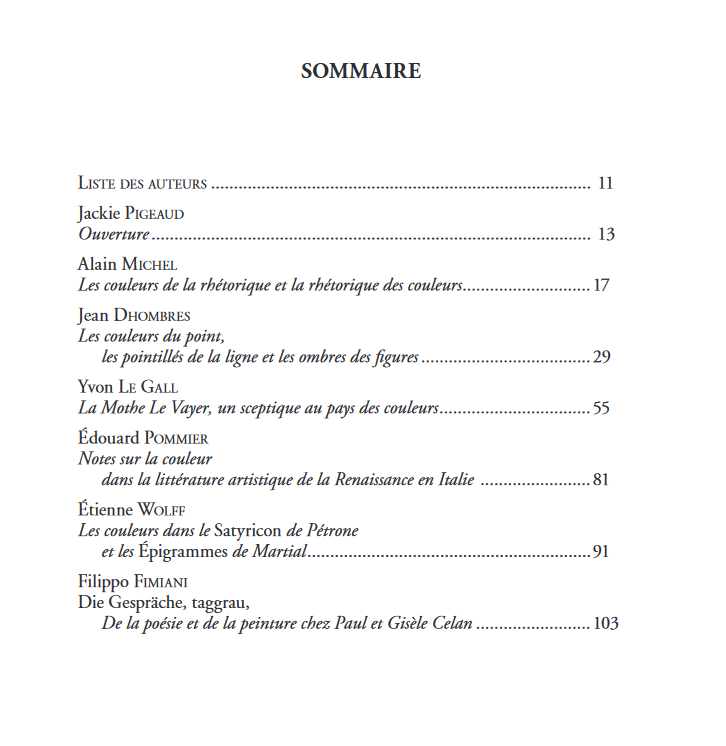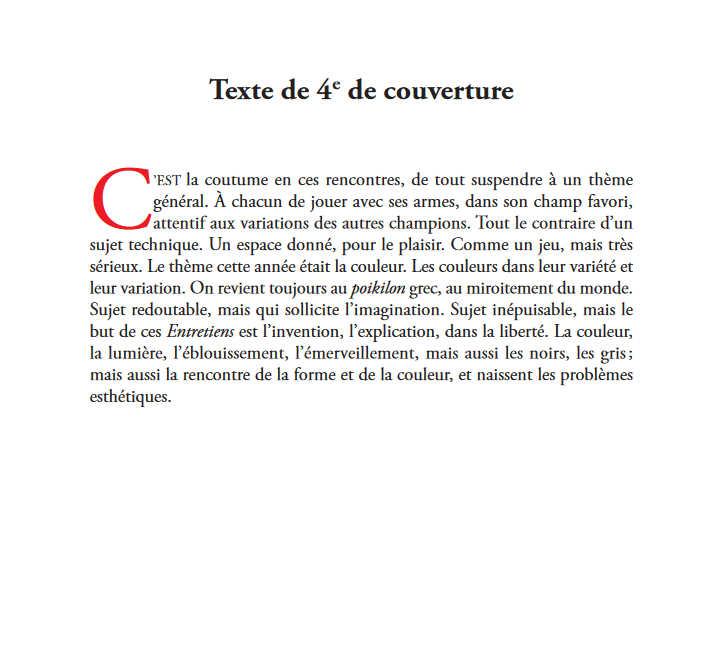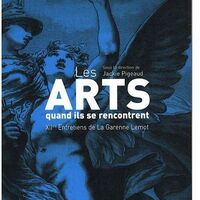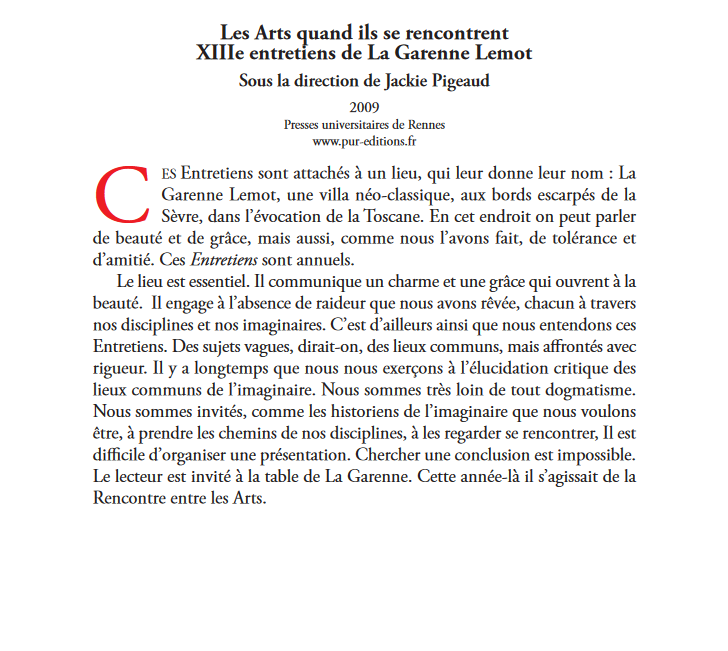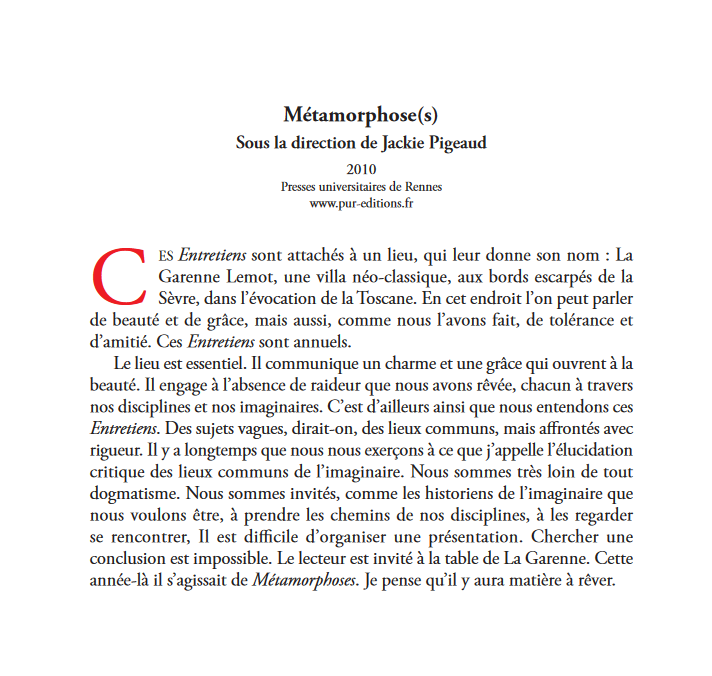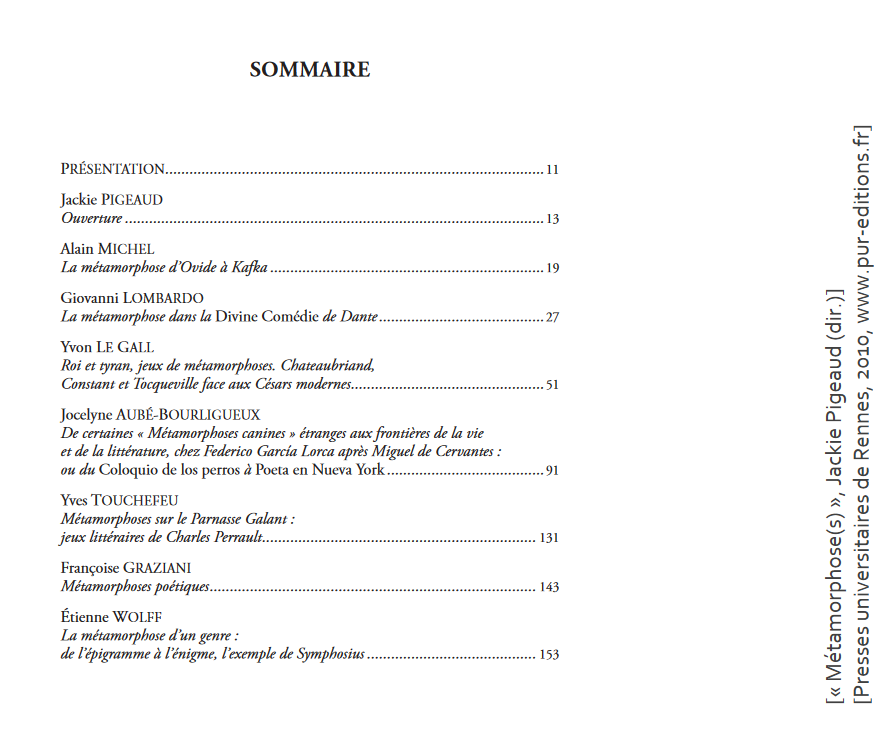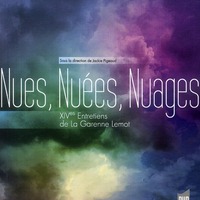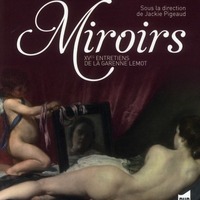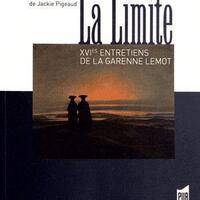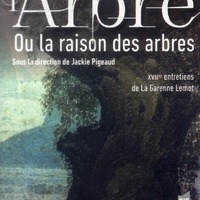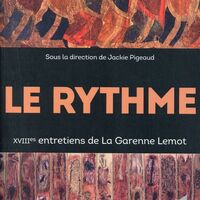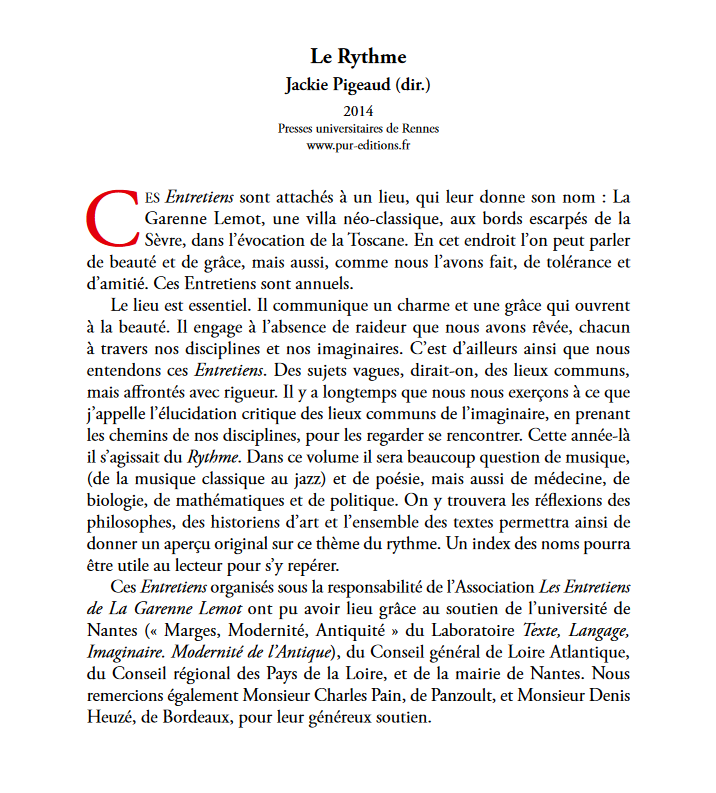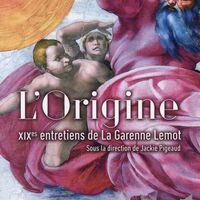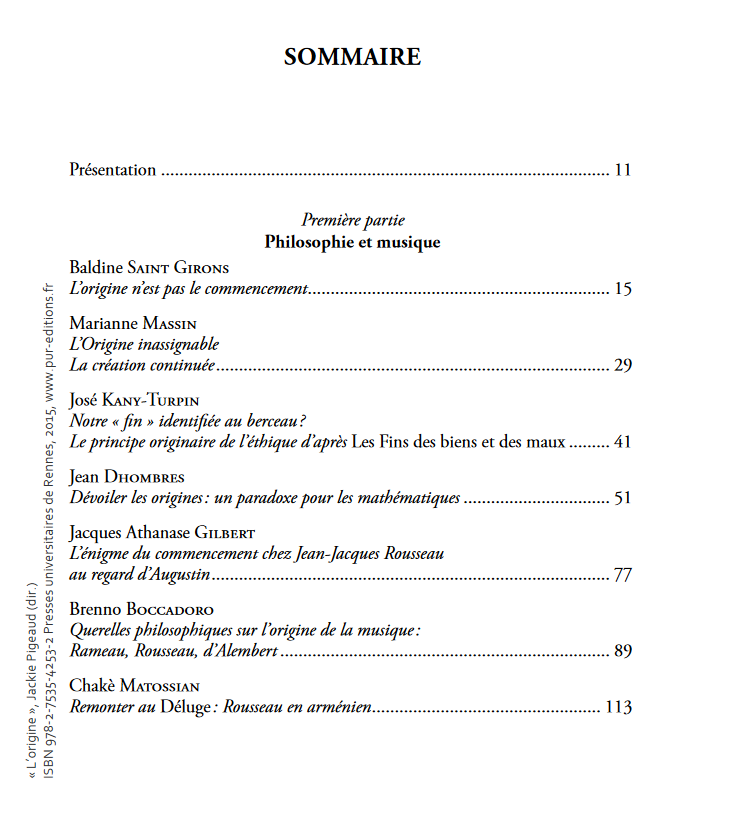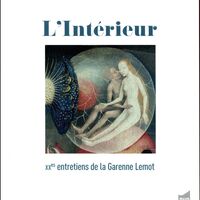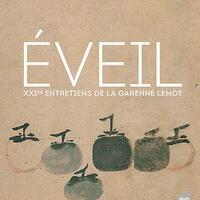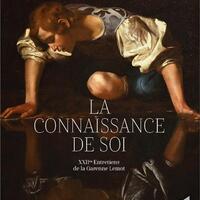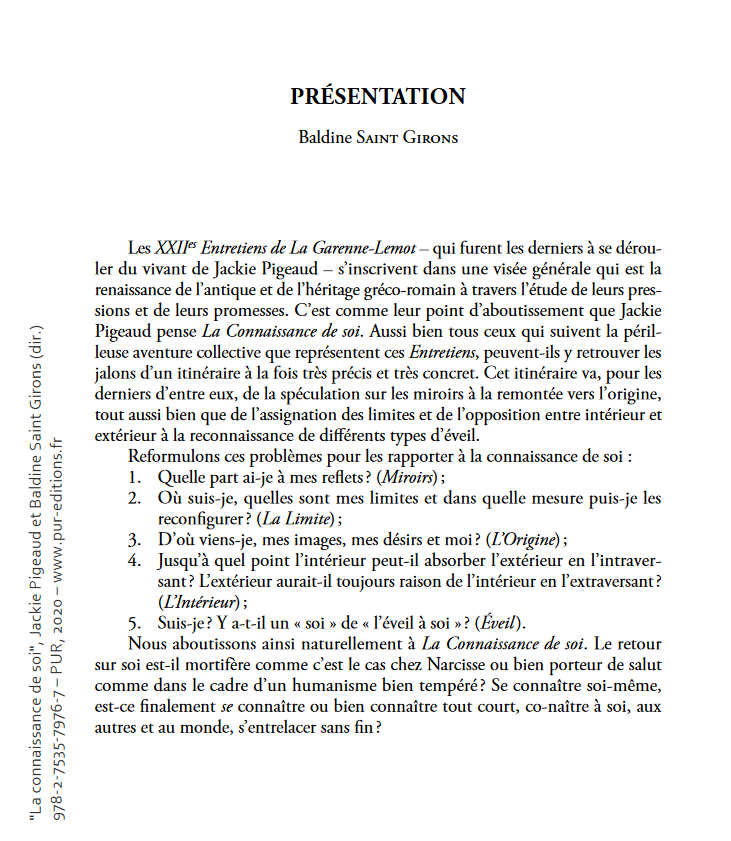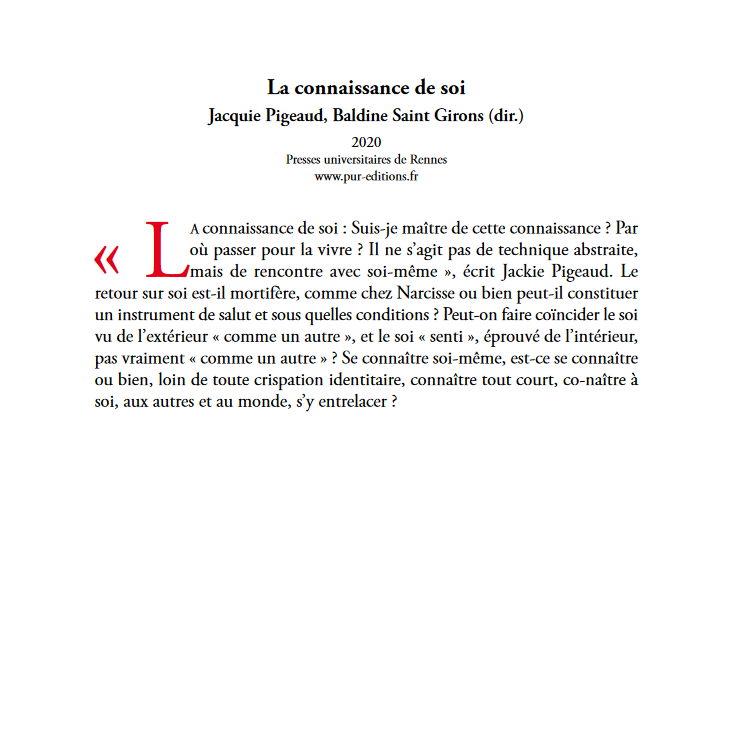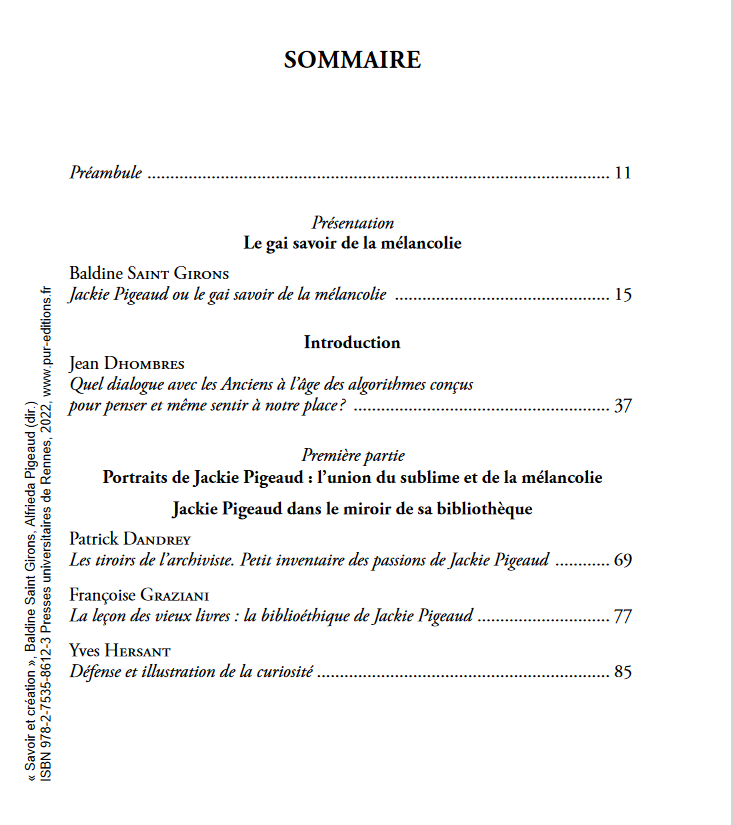Consulter les Entretiens (ouvrages)
I. Winckelmann et le retour à l'Antique

- Titre
- I. Winckelmann et le retour à l'Antique
- Droits
- Université de Nantes
- Type
- Actes de colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 1995-1996
- Description
-
""Les premiers Entretiens sont consacrés à l’œuvre de Winckelmann et à « la seconde Renaissance » de l’antique. Rappelons ici le scandale que constituait l’absence de traduction française aisément disponible du texte fondateur de l’histoire de l’art : la "Geschichte der Kunst des Altertums" (1764). Les vieilles traductions assez approximatives de Sellius (Dresde, 1764) et de Huber (Paris, 1789) occupaient maigrement le champ. C’est seulement en 2005 que fut publiée la précieuse traduction de Dominique Tassel.
Que ne devons-nous à Winckelmann ! C’est lui, par excellence, qui forge le rêve de la Grèce : rêve d’un art, d’une liberté et d’un bonheur encore repérables, mais déjà perdus. S’agit-il d’une chose redécouverte ou d’une chose purement imaginée ? Winckelmann est un Christophe Colomb d’un nouveau genre : il s’arrête en chemin. C’est depuis l’Urbs seulement que le fondateur de l’histoire de l’art prétend contempler la Grèce pour la réinventer à distance et partager l’émerveillement qu’elle suscite. "Torniamo a Roma, Revenons à Rome" ! Une identification, d’emblée, se dessine : celle de Jackie Pigeaud à Winckelmann et, à travers lui, à la grande figure d’Ariane, qu’évoque Catulle, arquée en arrière comme une bacchante, « le corps tendu pour voir 'prospectans' », écarquillant les yeux pour ne pas perdre de vue la voile du navire qui emporte son amant et s’évanouit dans le lointain.
La conclusion de "l’Histoire de l’art dans l’Antiquité" semble déjà donner tous les thèmes des Entretiens : recul des limites et difficultés du voyage, quête des origines, désir d’un dedans, éveil par le rêve … Je cite ces lignes fameuses :
"Le point auquel je suis parvenu dans l’histoire de l’art en dépasse déjà les limites et, bien qu’en examinant le déclin et la mort de cet art, je sois presque dans l’état d’esprit de celui qui, décrivant l’histoire de sa patrie, serait tenu d’en aborder la destruction qu’il a lui-même vécue, je n’ai pu m’empêcher de suivre le destin des œuvres d’art aussi loin que portait ma vue. Ainsi l’amante restée sur le rivage suit, les yeux baignés de larmes et sans espoir de le revoir, son amant qui prend la mer, et croit en voir l’image dans la voile déjà lointaine. Nous n’avons plus, comme l’amante, qu’une sorte d’ombre de l’objet de nos désirs ; mais cette silhouette nous fait d’autant plus regretter l’objet perdu. [...] Nous sommes bien souvent dans le cas de ceux qui, voulant connaître les spectres, croient les voir là où il n’y en a pas : le nom de l’Antiquité est devenu un préjugé ; mais même ce préjugé n’est pas sans utilité. Que l’on se propose de trouver beaucoup, et l’on cherchera beaucoup pour apercevoir quelque chose. […] On ne doit pas avoir honte de chercher la vérité, sa propre réputation dût-elle en souffrir, et les erreurs de quelques-uns sont nécessaires pour que beaucoup trouvent le bon chemin."
À travers ce dernier aveu particulièrement émouvant, Winckelmann rejoint Longin qui proclamait le droit à l’erreur de quiconque cherche sa voie sur des sentiers nouveaux. S’autoriser l’errance, en supporter vaillamment la honte, telles sont les conditions pour garder le fil de son rêve.""
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.159-160"| - Format
-
- Ouvrage format A4
- 185 pages
- 13 interventions -
 1_0_Table des Matières et introduction
1_0_Table des Matières et introduction
- - Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Winckelmann et son œuvre », p. 9-12.
-
 1_1_Jackie PIGEAUD - Winckelmann et son œuvre
1_1_Jackie PIGEAUD - Winckelmann et son œuvre
- - Édouard Pommier, Inspecteur Général Honoraire des Musées de France : « Winckelmann et la religion », p. 13-31.
-
 1_2_Edouard POMMIER - Winckelmann et la religion
1_2_Edouard POMMIER - Winckelmann et la religion
- - Alain Michel, Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « Winckelmann et l’esthétique antique », p.33-40.
-
 1_3_Alain MICHEL - Winckelmann et l'esthétique antique
1_3_Alain MICHEL - Winckelmann et l'esthétique antique
- - Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : «Winckelmann et l’allégorie », p. 41-48.
-
 1_4_Yves HERSANT - Winckelmann et l'allégorie
1_4_Yves HERSANT - Winckelmann et l'allégorie
- - Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « 'Torniamo a Roma' : vers quelle Antiquité ? », p. 49-65.
-
 1_5_Jackie PIGEAUD - Torniamo a Roma, vers quelle antiquité ?
1_5_Jackie PIGEAUD - Torniamo a Roma, vers quelle antiquité ?
- - Philippe Heuzé, Université de Nantes (latin) : « Winckelmann et la peinture ancienne », p. 67-71.
-
 1_6_Philippe HEUZE - Winckelmann et la peinture des anciens
1_6_Philippe HEUZE - Winckelmann et la peinture des anciens
- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « De l’emploi du terme ‘sublime’ chez Winckelmann », p. 73-83.
-
 01_7_Baldine SAINT-GIRONS - De l'interprétation du sublime chez Winckelmann
01_7_Baldine SAINT-GIRONS - De l'interprétation du sublime chez Winckelmann
- - Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, Paris, Université de Nantes (histoire des mathématiques et des sciences) : « La fin des mathématiques ou une nouvelle vie des formes ; Winckelmann et alii», p.85-95.
-
 1_8_Jean DHOMBRES - Sur des pensers nouveaux, révolution et tradition dans les sciences de la fin des Lumières
1_8_Jean DHOMBRES - Sur des pensers nouveaux, révolution et tradition dans les sciences de la fin des Lumières
- - Gérard Raulet, Université de Rennes (allemand) : « Winckelmann, un moderne chez les Anciens », p.97-110.
-
 1_9_Gérard RAULET - Winckelmann, un moderne chez les anciens
1_9_Gérard RAULET - Winckelmann, un moderne chez les anciens
- - Pascal Griener, Université de Berne, Suisse (histoire de l’art) : « La nécessité de Winckelmann : Hendrik Jansen (1741-1812) et la littérature artistique à la fin du XVIIIe siècle », p. 111-125.
-
 1_10_Pascal GRIENER - La nécessité de Winckelmann
1_10_Pascal GRIENER - La nécessité de Winckelmann
- - François Hartog, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire) : « Faire le Voyage d’Athènes : Johann Joachim Winckelmann et sa réception française », p. 127-143.
-
 1_11_François HARTOG - Faire le voyage d'Athènes, Johann Joachim Winckelmann et sa réception française
1_11_François HARTOG - Faire le voyage d'Athènes, Johann Joachim Winckelmann et sa réception française
- - Volkmar Hansen, Conservateur du Goethe-Museum de Düsseldorf, Allemagne : « Le programme artistique des Propyläen (1798-1800) », p. 145-151.
-
 1_12_Volkmar HANSEN - Le programme des Propylaen
1_12_Volkmar HANSEN - Le programme des Propylaen
- - Paola Faedo, Université de Pise, Italie (histoire de l’art) : « Francesco Algarotti, conservateur à Dresde avant Winckelmann. Remarques sur un parcours intellectuel », p. 153-171.
-
 1_13_Paolo FAEDO - Francesco Algarotti, conservateur à Dresde avant Winckelmann, remarques sur un parcours intellectuel
1_13_Paolo FAEDO - Francesco Algarotti, conservateur à Dresde avant Winckelmann, remarques sur un parcours intellectuel
- - Jean-Paul Barbe, Université de Nantes (allemand) : « L’Ardinghello et Heinse. L’autre retour à l’Antique », p. 173-184.
-
 1_14_Jean-Paul BARBE - L'Ardinghello de Heinse. L'autre retour à l'antique
1_14_Jean-Paul BARBE - L'Ardinghello de Heinse. L'autre retour à l'antique
- Editeur
- Université de Nantes
- Contributeur
-
Les instituts d'études anciennes et d'études germaniques
Littérature Médecine et Société
Centre culturel franco-allemand de l'Université de Nantes
L'institut universitaire de France
- Collections
- Publications : Université de Nantes
II. La redécouverte de la Grèce et de l’Égypte au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle
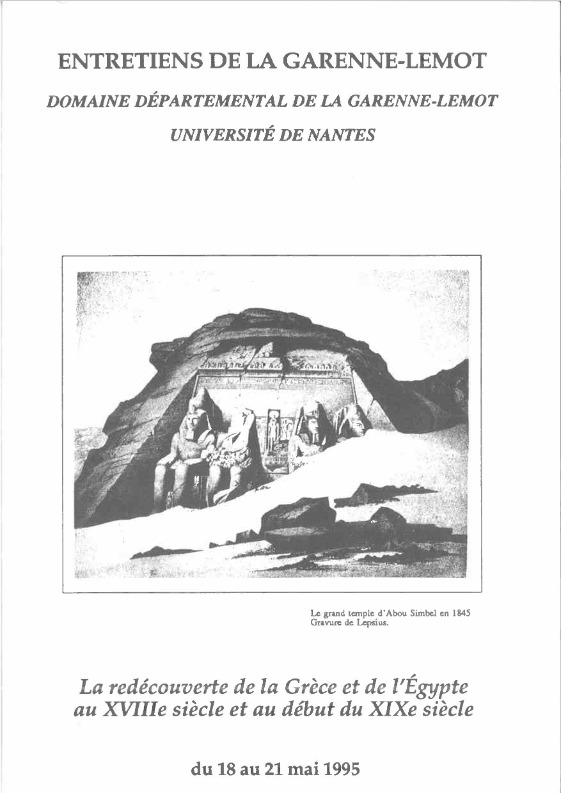
- Titre
- II. La redécouverte de la Grèce et de l’Égypte au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle
- Droits
- Université de Nantes
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 1997
- Description
-
"Dans "La redécouverte de la Grèce et de l’Égypte au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle", Jackie Pigeaud prend moins le parti des Grecs qu’on aurait pu le croire et oppose en un diptyque original et saisissant la Renaissance hippocratique de la fin du XVIIIe siècle à un anti-hippocratisme étrangement virulent qui s’appuie sur la médecine égyptienne d’avant Hippocrate. Médecins égyptiens contre Hippocrate, vitalistes contre mécanistes, Broussais contre Pinel, Houdart et Boulet contre Barthez et Winckelmann … C’est mythe contre mythe, rêve contre rêve. Mais les cartes se brouillent. Ne voilà-t-il pas que Vivant-Denon, pourtant winckelmannien, compare les "Colosses de Thèbes" au "Laocoon" et trouve dans « la nullité d’expression » des Colosses une gravité et une grandeur sublimes, assorties à l’architecture égyptienne ! Mais Winckelmann, lui-même, n’avait-il pas commencé à réhabiliter l’Egypte, lui qui citait la formule d’Homère sur « l’amère Égypte » et s’appuyait sur Strabon pour créditer les Égyptiens d’un « caractère sérieux et mélancolique » ? La mélancolie, on le sait, porte toujours chez Jackie Pigeaud les couleurs de la génialité, en dépit de l’abîme du pathologique qui la guette."
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.159-160"| - Format
-
_________________
- Ouvrage format A4
- 199 pages
- 15 interventions
_________________ -
 02_Couverture_4e_couverture
02_Couverture_4e_couverture
-
 02_00_Table des Matières
02_00_Table des Matières
-
- Alain Pons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Théorie de la mythologie chez Vico »,
p. 3-8. -
 02_01_Alain_PONS_ - Boria delle nazioni et Boria de dotti - Vico, le mythe de l'Egypte et des Hiéroglyphes
02_01_Alain_PONS_ - Boria delle nazioni et Boria de dotti - Vico, le mythe de l'Egypte et des Hiéroglyphes
- - Alain Michel, Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « Le voyage du jeune Anacharsis », p. 9-16.
-
 02_02_Alain_MICHEL-Le voyage du jeune Anacharsis ou la découverte du bonheur en Grèce
02_02_Alain_MICHEL-Le voyage du jeune Anacharsis ou la découverte du bonheur en Grèce
- - Jean Dhombres, CNRS, Centre François Viète, Nantes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Égyptologie sévère : Le regard grec des savants français de l’expédition d’Égypte », p. 17-40.
-
 02_03_Jean_DHOMBRES - Égyptologie sévère. Le regard grec des savants français de l'expédition d’Égypte.
02_03_Jean_DHOMBRES - Égyptologie sévère. Le regard grec des savants français de l'expédition d’Égypte.
- - Jean-Paul Barbe, Université de Nantes (allemand) : « De l’usage de la Grèce et de Rome dans la littérature engagée en Allemagne autour de 1800 », p. 41-51.
-
 02_04_Jean-Paul_BARBE - Du bon usage de la Grève et de Rome dans la littérature engagée en Allemagne autour de 1800.
02_04_Jean-Paul_BARBE - Du bon usage de la Grève et de Rome dans la littérature engagée en Allemagne autour de 1800.
- - Jean-Clément Martin, Université de Nantes (histoire) : « De l’usage de l’Antiquité pendant la Révolution française », p. 53-60.
-
 02_05_Jean-Clément_MARTIN - De l'usage de l'antiquité pendant la Révolution Française
02_05_Jean-Clément_MARTIN - De l'usage de l'antiquité pendant la Révolution Française
- - Yves Hersant, Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance): « La mort du Sphinx », p. 61-67.
-
 02_06_Yves_HERSANT - La mort du sphinx
02_06_Yves_HERSANT - La mort du sphinx
- - Jean-Pierre Adam, CNRS – Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, Paris : « Égypte : la curiosité et le prétexte », p. 69-93.
-
 02_07_Jean-Pierre_ADAM - Egypte, la curiosité et le prétexte
02_07_Jean-Pierre_ADAM - Egypte, la curiosité et le prétexte
- - Gunter Volz, Université de Nantes (allemand) : « Popularité et érudition : les références de l’Antiquité gréco-romine dans la presse allemande de l’Aufklärung », p. 95-105.
-
 02_08_Gunter_VOLZ - Popularité et érudition. Les références à l'antiquité gréco-romaine dans la presse allemande de l'Aufklärung.
02_08_Gunter_VOLZ - Popularité et érudition. Les références à l'antiquité gréco-romaine dans la presse allemande de l'Aufklärung.
- - Marie Pinel, Université de Nantes (littérature française) : « La Grèce imaginaire de Chateaubriand à travers l’Itinéraire de Paris à Jérusalem », p. 107-115.
-
 02_09_Marie_PINEL_La Grèce imaginaire de Chateaubriand à travers "L'itinéraire de Paris à Jérusalem"
02_09_Marie_PINEL_La Grèce imaginaire de Chateaubriand à travers "L'itinéraire de Paris à Jérusalem"
- - Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine), « Égypte contre Grèce. Un enjeu idéologique de l’histoire de la médecine », p. 117-130.
-
 02_10_Jackie_PIGEAUD - Égypte contre Grèce, un enjeu idéologique de l'histoire de la médecine
02_10_Jackie_PIGEAUD - Égypte contre Grèce, un enjeu idéologique de l'histoire de la médecine
-
- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) : « De Dupuis à Quatremère de Quincy. Les enjeux du paradigme hiéroglyphique dans la théorie de l’art à la fin du XVIIIe siècle »,
p. 131-142. -
 02_11_Pascal_GRIENER - De Depuis à Quatremère de Quincy. Les enjeux du paradigme hiéroglyphique dans la théorie de l'art à la fin du XVIIIe siècle.
02_11_Pascal_GRIENER - De Depuis à Quatremère de Quincy. Les enjeux du paradigme hiéroglyphique dans la théorie de l'art à la fin du XVIIIe siècle.
- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du sublime égyptien : Isis et les pyramides », p. 143-160.
-
 02_12_Baldine_SAINT-GIRONS - Du sublime égyptien : Isis et les pyramides
02_12_Baldine_SAINT-GIRONS - Du sublime égyptien : Isis et les pyramides
-
- Edouard Pommier, Inspecteur Général Honoraire des Musées de France : « Caylus et la Grèce »,
p. 161-175. -
 02_13_Edouard_POMMIER - Caylus et la Grèce
02_13_Edouard_POMMIER - Caylus et la Grèce
- - Jean-Marcel Humbert, Conservateur du patrimoine au service culturel du Musée du Louvre, Paris : « Sources multiples et incertaines : comment la redécouverte de l’Égypte s’est traduite dans l’art. Naissance de l’égyptomanie », p.177-189.
-
 02_14_Jean-Marcel_HUMBERT - Sources multiples et incertaines : Comment la redécouverte de l’Égypte s'est traduite dans l'art. Naissance de l'égyptologie.
02_14_Jean-Marcel_HUMBERT - Sources multiples et incertaines : Comment la redécouverte de l’Égypte s'est traduite dans l'art. Naissance de l'égyptologie.
- - Mariella Di Maio, Université de Salerne (littérature française) : « Nostalgies d’obélisques : l’Égypte de Théophile Gautier », p. 191-198.
-
 02_16_Mariella_DI-MAIO - Nostalgies d'obélisques _ L'Egypte de Théophile Gautier
02_16_Mariella_DI-MAIO - Nostalgies d'obélisques _ L'Egypte de Théophile Gautier
- Editeur
- Université de Nantes
- https://www.univ-nantes.fr/recherche-et-innovation/science-ouverte-et-publications
- Contributeur
-
Le C.R.I.N.I.
Le Centre François Viète (Littérature Médecine et Société)
Les Départements de Lettres Anciennes et d’Études Germaniques de l'Université de Nantes
- Collections
- Publications : Université de Nantes
III. Le culte des grands hommes au XVIIIe siècle
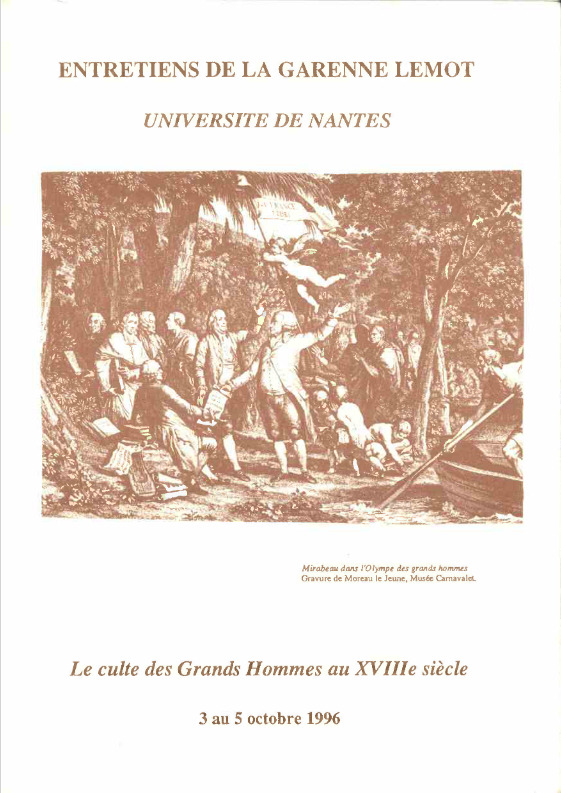
- Titre
- III. Le culte des grands hommes au XVIIIe siècle
- Droits
- Université de Nantes
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : février 1998
- Description
-
""L’hommage le plus saisissant à Hippocrate se trouve dans "Le culte des grands hommes au XVIIIe siècle".
Un véritable « culte » fut, en effet, voué aux « grands hommes », aux bienfaiteurs de l’humanité, et non plus aux héros, ces « saccageurs de province » (Voltaire), ni, bien sûr, aux people ou aux « célébrités », comme on dit aujourd’hui. Or, « Si jamais homme a reçu un culte, c’est bien Hippocrate, lui qui est traditionnellement 'prôtos euretês', Le Divin, le Bon, le Grand, le Sage, le Véridique » (p.234) : on l’appelle même en raccourci le divin Vieillard, qui est aussi le nom de "Lao zi" en Chine. Jackie Pigeaud prend deux repères : le discours latin (traduit en anglais) de Boerhaave à Leiden (1701) et celui de Barthez à Montpellier (1801). Au début du XVIIIe siècle, l’influence de Bacon est primordiale, comme le rappellent les éditeurs qui insistent sur le caractère expérimental de sa méthode. Mais un siècle plus tard, le vent a tourné. En revenir à Hippocrate, c’est comprendre le geste fondateur qui affirme l’autonomie de la médecine par rapport à la philosophie, tel que le rapporte Celse dans la préface du "De Medicina", rééditée par Philippe Mudry. Dès lors, le problème est de bien faire le départ entre les problèmes d’étiologie et les problèmes de description des maladies.
Dans cette dernière perspective, le plus nouveau est sans doute l’attribution à Hippocrate d’un talent de peintre. Ainsi Bordeu n’hésite-t-il pas à le créditer de « tableaux aussi parlants que ceux de Greuze », mettant en évidence « la position, les mouvements, la physionomie des malades ». Rappelons aussi le succès des Lettres d’Hippocrate qui contribuèrent beaucoup à forger son image, telle la lettre sur le rire et la folie qu’a traduite et présentée Yves Hersant. « Mon grand-père », écrivait Stendhal dans la Vie d’Henry Brulard, « adorait la correspondance apocryphe d’Hippocrate ».
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.161-162"| - Format
-
- 298 pages
- Format A4
- 20 interventions
_________________ - - Édouard Pommier, Inspecteur Général Honoraire des Musées de France : « L’invention du monument aux grands hommes (XVIIIe siècle) », p. 7-23.
-
 3_1_Edouard POMMIER - L'invention du monument aux Grands Hommes (XVIIIe siècle)
3_1_Edouard POMMIER - L'invention du monument aux Grands Hommes (XVIIIe siècle)
- - Dominique Poulot, Université de Tours (histoire moderne) : « Les grands hommes au musée sous la Révolution et l’Empire : le cas du Musée des Monuments français », p. 25-41.
-
 3_2_Dominique POULOT - Les Grands Hommes au musée sous la Révolution et l'Empire : le cas du Musée des Monuments Français
3_2_Dominique POULOT - Les Grands Hommes au musée sous la Révolution et l'Empire : le cas du Musée des Monuments Français
- - Philippe Roger, Université de Paris IV-Sorbonne (langue et littérature françaises XVIIe et XVIIIe siècles), CNRS, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de recherches sur l’Europe) : « Les ‘grands hommes’ de Rivarol », p. 43-52.
-
 3_3_Philippe ROGER - Les "grands hommes de Rivarol"
3_3_Philippe ROGER - Les "grands hommes de Rivarol"
- - Jean-Claude Bonnet, Université de Paris IV-Sorbonne, CNRS, Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature françaises des XVIIe et XVIIIe siècles : « Les arts au service du culte des Grands hommes», p. 53-57.
-
 3_4_Jean-Claude BONNET _ Les arts au service du culte des grands hommes
3_4_Jean-Claude BONNET _ Les arts au service du culte des grands hommes
- - Roland Bernecker, Université de Nantes, Directeur du Centre Culturel Franco-Allemand, Nantes : « L’héroisme chez Alfieri », p. 59-68.
-
 3_5_Roland BERNECKER - L'héroïsme chez Alfieri
3_5_Roland BERNECKER - L'héroïsme chez Alfieri
- - Pascal Griener, Université de Neuchâtel (histoire de l’art) : « Les Grands Anonymes de l’histoire de l’art, ou l’envers du culte des Grands Hommes », p. 69-77.
-
 3_6_Pascal GRIENER - Les grands anonymes de l'histoire de l'art
3_6_Pascal GRIENER - Les grands anonymes de l'histoire de l'art
- - Jean-Paul Barbe, Université de Nantes (allemand) : « Du statut des Grands Hommes en Utopie. Analyse du discours utopique allemand à la fin du XVIIIe siècle », p. 79-88.
-
 3_7_Jean-Paul BARBE - Du statut des Grands Hommes en utopie
3_7_Jean-Paul BARBE - Du statut des Grands Hommes en utopie
- - Philippe Heuzé, Université de Nantes (latin) : « Le grand homme d’après Cornélius Nepos », p.89-93.
-
 3_8_Philippe HEUZE - Le Grand Homme d'après Cornelius Nepos
3_8_Philippe HEUZE - Le Grand Homme d'après Cornelius Nepos
- - Marie-Jeanne Ortemann, Université de Nantes (anglais) : « William Blake héros de soi-même », p.95-102.
-
 3_9_Marie-Jeanne ORTEMANN - William Blake, héros de soi-même
3_9_Marie-Jeanne ORTEMANN - William Blake, héros de soi-même
- - Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « L’invention d’Ossian », p. 103-107.
-
 3_10_Yves HERSANT - L'invention d'Ossian
3_10_Yves HERSANT - L'invention d'Ossian
- - Pierre Carboni, Université de Nantes (anglais) : « Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son Lycurgue corse », p. 108-118.
-
 3_11_Pierre CARBONI - Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son Lycurge corse
3_11_Pierre CARBONI - Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son Lycurge corse
- - Jean Dhombres, CNRS, Centre François Viète, Nantes, École de Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Newton effaçant Descartes, Descartes parce que Newton. L’intérêt de bien choisir ses illustres, ou la déontologie de la profession intellectuelle au temps des Lumières », p. 119-138.
-
 03_12_Jean DHOMBRES - Newton effaçant Descartes, Descartes parce que Newton. L'intérêt de bien choisir ses illustres, ou la déontologie de la profession intellectuelle au temps des Lumières.
03_12_Jean DHOMBRES - Newton effaçant Descartes, Descartes parce que Newton. L'intérêt de bien choisir ses illustres, ou la déontologie de la profession intellectuelle au temps des Lumières.
- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Grand homme, génie, sublime», p. 139-151.
-
 03_13_Baldine SAINT-GIRONS - Grand Homme, Génie, Sublime
03_13_Baldine SAINT-GIRONS - Grand Homme, Génie, Sublime
- - Gerhardt Stenger, Université de Nantes (allemand) : « L’homme de bien, le génie et le sage : variations autour du thème du grand homme chez Diderot », p. 153-163.
-
 03_14_Gerhardt STENGER - L'Homme de bien, le Génie et le Sage : variations autour du thème du Grand Homme chez Diderot
03_14_Gerhardt STENGER - L'Homme de bien, le Génie et le Sage : variations autour du thème du Grand Homme chez Diderot
- - Yves Touchefeu, Professeur de Première Supérieure, Nantes : « Jean-Jacques Rousseau et ses grands hommes : Brutus, Caton et le petit Spartiate », p. 165-177.
-
 03_15_Yves TOUCHEFEU - Jean-Jacques Rousseau et ses Grands Hommes : Brutus, Caton et le Petit Spartiate
03_15_Yves TOUCHEFEU - Jean-Jacques Rousseau et ses Grands Hommes : Brutus, Caton et le Petit Spartiate
- - Alain Michel, Université de Paris IV-Sorbonne (latin), Membre de l’Institut : « Vico et les grands hommes », p.179-185.
-
 03_16_Alain MICHEL - Vico et les Grands Hommes
03_16_Alain MICHEL - Vico et les Grands Hommes
- - Mark K. Deming, École d’Architecture de Paris-Belleville : « Le Panthéon français, du temple à la pyramide », p. 187-201.
-
 03_17_Mark K. DEMING - le Panthéon français, du temple à la pyramide
03_17_Mark K. DEMING - le Panthéon français, du temple à la pyramide
- - Daniel Rabreau, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Centre d’Histoire de l’Art et d’Archéologie : « Les Grands Hommes sculptés ‘à l’antique’. Rituels, ressemblance stylistique et idéal civique à l’époque des Lumières », p. 203-218.
-
 03_18_Daniel RABREAU - Les Grands Hommes sculptés à l'antique
03_18_Daniel RABREAU - Les Grands Hommes sculptés à l'antique
- - Jean-Marcel Humbert, Musée de la Légion d’Honneur, Paris : « Entre mythe et archéologie : la fortune statuaire égyptisante de Desaix et Kléber », p. 219-232.
-
 03_19_Jean-Marcel HUMBERT - Entre mythe et archéologie: la fortune statuaire égyptisante de Desaix et Kléber
03_19_Jean-Marcel HUMBERT - Entre mythe et archéologie: la fortune statuaire égyptisante de Desaix et Kléber
- - Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine): « La figure d’Hippocrate au XVIIIe siècle », p. 233-244.
-
 03_20_Jackie PIGEAUD - La figure d'Hippocrate au XVIIIe siècle
03_20_Jackie PIGEAUD - La figure d'Hippocrate au XVIIIe siècle
- Editeur
- Université de Nantes
- Contributeur
-
Le C.R.I.N.I.
Le Centre François Viète (Littérature Médecine et Société)
Les Départements de Lettres Anciennes cl d’Études Germaniques de l'Université de Nantes
Avec le concours du Domaine de la Garenne Lemot- Conseil Général de Loire Atlantique et de la Mairie de Nantes
- Collections
- Publications : Université de Nantes
IV. Lecture du jardin | Histoires de jardins, lieux et imaginaires
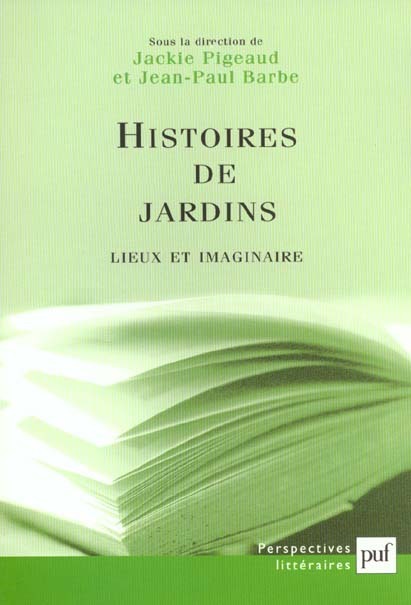
- Titre
- IV. Lecture du jardin | Histoires de jardins, lieux et imaginaires
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 2001
- Description
-
"Revenons au site de La Garenne-Lemot. Il n’y a pas de plus bel incipit que celui de nos quatrièmes entretiens : Histoires de jardins – Lieux et imaginaire. La beauté des lieux commande les thématiques, tissant un lien étroit entre les grands hommes des Entretiens III et les jardins des Entretiens IV.
La Garenne-Lemot est un lieu qui s’ouvre, plein de douceur. La corbeille du balcon nous reçoit dans un nid de courbes accueillantes, et l’escalier conduit à la Galerie des Illustres, où la grande table installée s’offre aux Entretiens. Un coup d’œil au balcon, du côté de la Sèvre, et vous êtes en Toscane. Mais ici, partout, nous sommes à Tusculum. C’est-à-dire que le dialogue, le dialogue harmonieux, la joute précise, en beau langage et belle façon, s’exerce en liberté ; l’anachronisme n’est pas fâcheux ; il s’agit bien de faire de cet endroit réel un lieu imaginaire.
L’imaginarisation, l’onirisation, voilà ce que réussit la culture en acte. Mais Jackie d’ajouter : « C’est aussi là que vaguement, autour des monuments vides et comme désemparés, flotte la mélancolie qui est l’accord obligé de l’épicurisme ». Les ombres, les fantômes, les reflets, toutes ces formes amies qui naissent des songes et d’une rêverie commune, acclimatée, prêtent à nos existences furtives l’équivalent d’une consistance.
Jackie Pigeaud nous propose alors de lire Rapin dans son latin originaire. Étant donné que l’agriculture était « après l’art de vaincre, l’art favori de Romains », ce que le XVIIIe siècle retient des "Géorgiques", c’est autant « la résistance de la nature » que l’incarnation de rêves déterminés. Aussi bien la vérité du jardin se trouve-t-elle dans le potager et le verger, ceux du vieillard de Tarente des "Géorgiques IV" : un jardin grâce auquel l’homme règle ses rapports avec la nature et réussit à se suffire à lui-même."
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.161-162"| - Format
-
-288 pages, format A4
- 14 interventions (retranscrites)
_________________ -
- Philippe Nys, Collège International de Philosophie, Paris : « L’art des jardins 'in situ' peut-il être tragique ? », p. 1-24.
- Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « De l’utopie à l’uchronie. Variation sur un thème jardinier », p. 25-47.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Le paysage et la question du sublime », p. 49-83.
- Alain Michel, Professeur honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « De Virgile à Juste Lipse : sagesse et beauté du jardin », p. 85-95.
- Yolaine Escande, CNRS, (esthétique) : « Jardins et peinture de paysages en Chine », p. 97-126.
- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Le jardin dans la théorie des arts de la Renaissance », p. 127-140.
- Isabelle Trivisani-Moreau, Université d’Angers (littérature française) : « Le jardin dans les premières nouvelles du "Mercure Galant" », p.141-157.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes (latin), Institut Universitaire de France : « Du Père Rapin à Delille », p. 159-180.
- Jean-Marcel Humbert, Musée de la Marine, Paris : « Les fabriques égyptisantes, entre exotisme et ésotérisme », p. 181-200.
- Jean-Paul Larthomas, Université de Nice, (philosophie) : « Le jardin selon Shaftesbury. Une origine possible du romantisme », p. 201-215.
- Jean-Louis Haquette, Université de Lille (anglais) : « Paysage et personnage : un aspect du jardin paysager dans les romans anglais du XVIIIe siècle », p. 217-227.
- Jean-Paul Barbe, Professeur honoraire de l’Université de Nantes (allemand) : « Discours du jardin / discours au jardin : la situation allemande à la fin du XVIIIe siècle », p. 229-250.
- Cecilia Hurley, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) et Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) : « Wilhelm von Humboldt au jardin du Musée des monuments français (1799). Une expérimentation allemande de l’histoire », p. 251-267.
- Fritz Nies, Université de Düsseldorf, Allemagne (romaniste) : « "Reading in the garden". Images au fil d’un demi-millénaire », p. 269-286. - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
V. La tolérance

- Titre
- V. La tolérance
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
-
Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 2000
- Description
-
Trouver la bonne distance, apprendre à la régler, c’est un problème à la fois théorique et pratique ; et, s’il nous fallait étudier la tolérance, c’était pour tenter de penser non pas séparément, mais ensemble, ses différentes dimensions. « Aussi douloureux que cela puisse être pour le philologue classique », insiste Jackie Pigeaud, « il lui faut bien convenir que l’idéal grec, tel qu’il s’est élaboré à la fin du XVIIIe siècle, a servi à constituer une norme raciale et raciste qui nous est insupportable ». Voilà de détestables théories qui ont la vie longue. Un crâne trop réduit, un angle facial trop large, une disparité trop accentuée entre la hauteur de la tête et la stature, et voilà que vous êtes qualifié d’ « idiot » par Pinel lui-même. La définition fonctionne comme une exclusion. Que sont le pongo, l’idiot, le cagot, pour parler comme Esquirol ? Sont-ce des sauvages ? Sont-ce des hommes ? Jackie Pigeaud s’appuie sur Rousseau, Linné, de Paw, Itard, pour montrer combien la mixité fascine au tournant des Lumières et au XIXe siècle.
Ici l’imaginaire est à la fois ce contre quoi il faut lutter et ce dont il importe de restituer les droits. « Ma sœur la sirène, mon frère l’orang-outang », écrit affectueusement Pigeaud. Socrate était-il fou comme prétendit le démontrer Lelut en 1836 ? Accrochons-nous à l’idée suivante : « Nous serions inquiet par une pensée qui voudrait bannir, évacuer le démon de Socrate. Nous croyons que toute pensée vraiment profondément rationnelle, doit s’appliquer à sauver le démon de Socrate ».
Qu’implique pareille position ? D’une part, il faut nous méfier des définitions comme étant ce que Jackie Pigeaud appelle des « sanctions trop rapides de la limite ». D’autre part, il faut en revenir à un être ambigu, mixte, proprement énigmatique : « Il est à l’origine de notre philosophie. Et c’est lui qu’il faut penser, comme l’énigme de l’Autre ». Jackie Pigeaud avait décidément l’art de nous dévoiler les trésors que recèle une incertitude bien placée.
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.163"| -
 Présentation des 5èmes entretiens de la Garenne Lemot
Présentation des 5èmes entretiens de la Garenne Lemot
- Format
-
- Format A4
- 305 pages
- 20 interventions
_________________ -
- Eric van der Schueren, Université de Laval, Canada, directeur de la publication : « Présentation », p.7-23.
- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « A propos de l’Édit de Nantes : la tradition latine et la tolérance », p. 25-35.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle (latin) : « Énée sur le chemin de la tolérance », p. 37-43.
- Henri Lavagne, École pratique des Hautes Études, Paris (IVe section – histoire) : « La tolérance de l’Église et de l’État à l’égard des œuvres d’art du paganisme dans l’Antiquité tardive », p. 45-54.
- Édouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Diabolisation, tolérance, glorification ? La Renaissance et la sculpture antique », p. 55-70.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Le Traité de la peinture et de la sculpture de G. Domenico Ottonelli et Pietro da Cortona. La fin des imprécateurs ? », p. 71-93.
- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, Centre François Viète, Nantes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Aurait-il aussi fallu des édits de tolérance en science au XVIe siècle ? », p. 95-109.
- Patrick Dandrey, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature française –XVIIe) : « Éloge de la frivolité. Tolérance et idéal mondain au XVIIe siècle », p.111-123.
- Jean-Michel Vienne, Université de Nantes (philosophie) : « La tolérance de Spinoza à Locke », p.125-132.
- Jean-Pierre Cléro, Université de Rouen (philosophie) : « L’utilité est-elle le meilleur fondement de la tolérance ? », p. 133-146.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « La tolérance est-elle une vertu?», p. 147-160.
- Philippe Roger, Université de Paris IV-Sorbonne (langue et littérature françaises XVIIe et XVIIIe siècles), CNRS, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de recherches sur l’Europe), Paris : « Tolérance et ‘minorités’ à l’âge des Lumières », p. 161-173.
- Pierre Carboni, Université de Nantes (anglais) : « La tolérance et la norme dans l’expression nationale écossaise au XVIIIe siècle : L’anglais face aux langues vernaculaires », p. 175-183.
- Gunter Volz, Université de Nantes (allemand) : « La paix civile grâce à la tolérance religieuse. Quelques options dans la presse allemande de la fin du XVIIIe siècle », p. 185-200.
- Michelle Gendreau-Massaloux, Conseillère d’État ; ancien recteur de l’Académie de Paris ; Chancelier des Universités : « Réflexions d’une hispaniste », p. 201-210.
- Nicole Dhombres, historienne, Nantes : « Lazare Carnot l’encyclopédiste : théologie, morale et politique de la tolérance », p. 211-219.
- Michel Delon, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature française – XVIIIe) : « La tolérance en amour : de Sade à Fournier », p. 221-229.
- Jean-Paul Barbe, Professeur honoraire à l’Université de Nantes (allemand) : « Le moine, le juif, le nègre. Ou le cercle des intolérances », p. 231-241.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Membre de l’Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : Le pongo, l’idiot et le cagot. Quelques remarques sur la définition de l’autre », p.243-262.
- David Spurr, Université de Neuchâtel, Suisse (anglais) : « La comédie de l’intolérance chez Joyce et Proust », p. 263-278. - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
VI. Les Académies (Antiquité - XIXe siècle)

- Titre
- VI. Les Académies (Antiquité - XIXe siècle)
- Droits
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 2005
- Description
-
"Les Académies, Jackie Pigeaud en revient aux « émerveillés du XVIIe siècle » qui collectent et interprètent les merveilles d’une nature toujours prodigue de création. « Il n’y a pas de limites au "foecundus Parens" ». « C’est que la nature, dans sa force et dans sa majesté, comme l’écrit Pline, dépasse à chaque instant nos prévisions si, du moins, nous la scrutons en détail, sans nous contenter d’une vue d’ensemble ». Jackie Pigeaud expose le mode de fonctionnement et les découvertes de l’Académie léopoldine des Curieux de nature, fondée à Schweinfurt en 1652 et dont les membres empruntaient leurs noms aux Argonautes. De somptueux exemples de curiosité sont alors donnés, qui forment le germe du livre "Les Curieux de Nature", publié chez Tautem en 2017 : rave à figure humaine, crucifix dans une racine, crevettes ailées, fleurs anthropomorphes… « Je suis prêt à accueillir la sirène ou l’homme sylvestre. L’humanité n’est pas close », déclare Jackie, nous invitant plaisamment à poursuivre. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.163-164"| - Format
-
- 290 pages
- 18 interventions (15 retranscrites)
_________________ -
- Eric van der Schueren, Université de Laval, Canada, directeur de la publication : « Présentation : pour une histoire poétique de l’Académie », p. 1-39.
- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « Cicéron, l’Académisme et les Académies », p. 41-52.
- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Le paradoxe de Mistra », p. 53-61.
- Étienne Wolff, Université de Nantes (latin) : « Érasme et l’Académie aldine », p. 63-72.
- Pierre Brunel, Université de Paris IV-Sorbonne, Institut Universitaire de France (littérature comparée) : « L’Académie florentine et la naissance de l’opéra », p. 73-83.
- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Les images de l’Académie : L’exemple de Florence », p. 85-103.
- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse (histoire de l’art) : « "L’école d’Athènes" de Raphaël : une métaphore de l’Académie », p. 105-118.
- Christian Michel, Université de Paris X–Nanterre (histoire de l’art) : « Comment distinguer les sœurs jumelles ? La sculpture au sein de l’Académie royale de peinture et de sculpture », p. 119-134.
- Didier Laroque, Professeur à l’École d’Architecture de Paris : « Piranèse et l’École romaine », p.135-149.
- Colette Nativel, Université de Paris I (latin, histoire de l’art) : « Académie et pédagogie de l’art en Angleterre – Le cicéronisme de Reynolds », p. 151-168.
- Thomas W. Gaehtgens, Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris (histoire de l’art) : « De la fin du modèle académique dans les beaux-arts en Allemagne », p. 168-190.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « "Academia nox". L’expression picturale de la nuit », p. 191-214.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « L’Académie des Curieux de Nature », p. 215-231.
- Jean Dhombres, CNRS, Centre François Viète, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Un seul ‘côté’ des objets. Stendhal et l’académisme mathématique », p. 233-267.
- Geneviève Rousseau (Université Laval) : « Orientations bibliographiques (1960-2000) », p. 269-290.
_________________
Interventions non publiées :
- Andrea Emiliani, Academia dei Lancei, Bologne, Italie, Inspecteur honoraire des Musées : « L’Accademia Clementina ».
- Michelle Gendreau-Massaloux, Conseillère d’État ; ancien recteur de l’Académie de Paris ; Chancelier des Universités, Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Paris : « Académies et disciplines académiques dans le Portugal du XVIIIe siècle ».
- Philippe Mudry, Université de Lausanne, Suisse (latin) : « L’invention du monde de Pline à Buffon». - Editeur
-
Publication des Actes : Les Presses de l'Université de Laval, collection "La République des Lettres"; Québec, Canada, 2005
(2005, ISBN 978-2-7637-8285-0) - https://www.pulaval.com/livres/les-academies-antiquite-xixe-siecle-sixiemes-entretiens-de-la-garenne-lemot
-
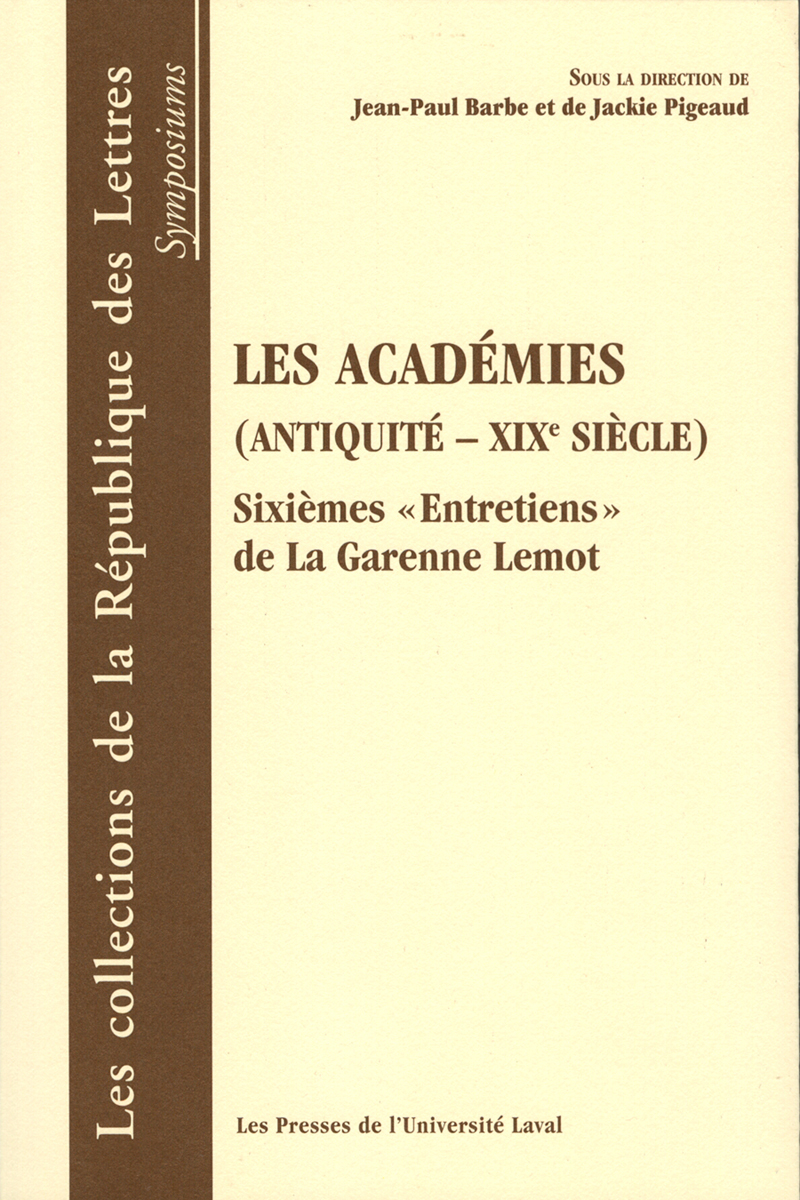 VI. Sixièmes Entretiens - Les Académies
VI. Sixièmes Entretiens - Les Académies
VII. Les Voyages, rêves et réalités
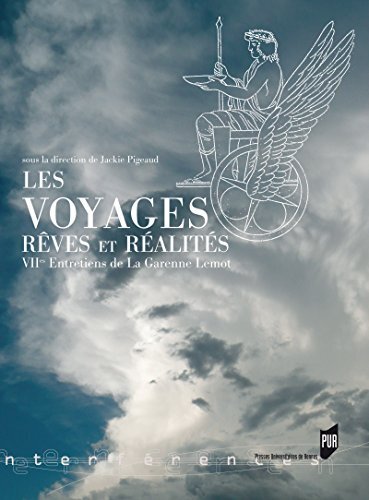
- Titre
- VII. Les Voyages, rêves et réalités
- Droits
- Presses universitaires de France (PUR)
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 2008
- Description
-
Ces VIIes Entretiens de la Garenne Lemot sont consacrés au voyage : sa poétique, son imaginaire, ses enseignements tels qu'ont pu les incarner des voyageurs réels ou littéraires comme Homère, Mario Praz, Théophile Gautier ou Magister Gregorius. Ces entretiens sont aussi voyages et rencontres entre les savoirs, où le lecteur est invité lui aussi à devenir un «historien de l'imaginaire», au-delà de sa discipline.
_________________
Résumé proposé par les Presses Universitaires de Rennes
_________________
" "Les Voyages" forment un diptyque avec les jardins : tous deux sont à la fois réels et imaginaires et constituent des remèdes contre la folie. Comme l’écrit à son fils le Dr Tulp dans une lettre que Jackie Pigeaud aimait à citer, observer, c’est repérer des gués et des passages, réussir à en faire la cartographie, délinéer les voies sinueuses et étroites. Tout comme le jardin, le voyage est ce qui nous rend alors sensible à l’exceptionnel et au merveilleux. En se tournant vers Virgile, Catulle ou Lucien, on comprend l’étonnement philosophique – ou plutôt l’étonnement poétique – qu’il cause non seulement aux voyageurs, mais à une nature autochtone qui les regarde. Ainsi les eaux du Tibre sont-elles pénétrées d’admiration pour le navire d’Énée qui se propulse dans l’inconnu.
'Labitur unda vadis abies, mirantur et undae…'
Le pin huilé glisse sur l’eau profonde et les ondes l’admirent,
Le bois, surpris, admire les boucliers des guerriers qui étincellent
Au loin sur le fleuve…
De même, chez Catulle, la nef des Argonautes semble replonger au commencement du monde. Et Jackie Pigeaud entreprend alors de nous peindre un voyage dans le voyage, en revenant à Ariane dont l’image arquée, dominant la mer pour y chercher la voile qui s’éloigne, apparaît sur la vestis, le drap nuptial, qui recouvre les amours de Thétys et de Pélée. Dans sa traduction des vers 267-277, Jackie Pigeaud laisse éclater son génie poétique : « le Zéphyr fait frissonner la mer paisible ; il excite les eaux qui courbent la tête. […] Nageant, [les vagues] reluisent d’une lumière pourpre ». Les convives se séparent, joyeux : la jeunesse thessalienne rentre chez elle. Arrivent alors les dieux ; mais les Parques leur annoncent la multiplication des crimes et le malheur de l’humanité :
[…] Les dieux ne jugent plus digne de rendre visite à de telles assemblées.
Ils ne permettent plus qu’on les touche dans la lumière claire »
(Nec se contingi patiuntur lumine claro).
Et, de fait, « Jamais plus à l’horizon nous ne verrons défiler le cortège des dieux », conclut alors Jackie Pigeaud.
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.162-163"| - Format
-
- 220 pages
- 20 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture », p. 11-15.
- Alain Michel, Professeur honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « La poétique du voyage : d’Homère à la modernité », p. 17-32.
- Jean-Pierre Cléro, Université de Rouen (philosophie) : « Voyage et herméneutique », p. 33-55.
- Didier Laroque, Professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris : « Le voyage immobile de Mario Praz », p. 57-66.
- Yves Hersant, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « ’Grand tour’ et Lumières », p.67-76.
- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse, (histoire de l’art) : « Epiphanie et signification ; le Grand Tour et la rencontre avec l’œuvre d’art au XVIIIe siècle », p. 77-100.
- Gunter Volz, Université de Nantes (allemand) : « Un Candide bavarois : le Faustin de Johann Pezzl (1783)", p. 101-117.
- Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « Les bagages d’un voyageur : Théophile Gautier en Orient », p. 119-131.
- Etienne Wolff, Université de Nantes (latin) : « Un voyageur à Rome aux XIIe-XIIIe siècles : Magister Gregorius », p. 133-141.
- Andrea Emiliani, Academia dei Lancei, Bologne, Italie, Inspecteur honoraire des Musées : « La protection du patrimoine artistique en Italie : survol historique. », p. 143-154.
- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Le voyage de Taddeo », p. 155-170.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Vers une philosophie du voyage : Madame de Staël », p. 171-186.
- Françoise Knopper, Université de Toulouse (littérature allemande) : « Les ambitions de l’éditeur berlinois Friedrich Nicolai (1733-1811) : entre encyclopédie et patriotisme », p. 187-201.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Le dernier voyage : étude sur le poème 64 de Catulle. », p. 203-215.
Interventions non publiées (parution tardive) :
- Jean-Paul Barbe, Professeur honoraire à l’Université de Nantes (allemand) : « Voyage et discontinuité au XVIIe siècle : le passage de la frontière. »
- Pierre Brunel, Université de Paris IV-Sorbonne, Institut Universitaire de France (littérature comparée) : « Le voyage de Meroë. »
- Michel Delon, Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIIe) : « Le voyage de l’aventurier au siècle des Lumières ».
- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, (histoire des mathématiques et des sciences) : « Le voyage des intellectuels européens vers le Paris post-révolutionnaire des années 1800 ».
- Anne Rolet, Université de Nantes (latin) : « Du voyage comme métaphore : errance et salut dans deux emblèmes d’Achille Bocchi (1555) ».
- Gianni Venturi, Université de Ferrare (littérature) : « Le voyage dans le songe de Poliphile ». - Editeur
- Presses Universitaires de Rennes (PUR)
- https://pur-editions.fr/product/4590/les-voyages-reves-et-realites
- Contributeur
-
L'Institut Universitaire de France
Le C.R.I.N.I.
Les Départements de Lettres Anciennes et d'Etudes Germaniques de l'Université de Nantes
Avec le concours du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire Atlantique et de la Mairie de Nantes - Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.41021
VIII. Les Sybilles
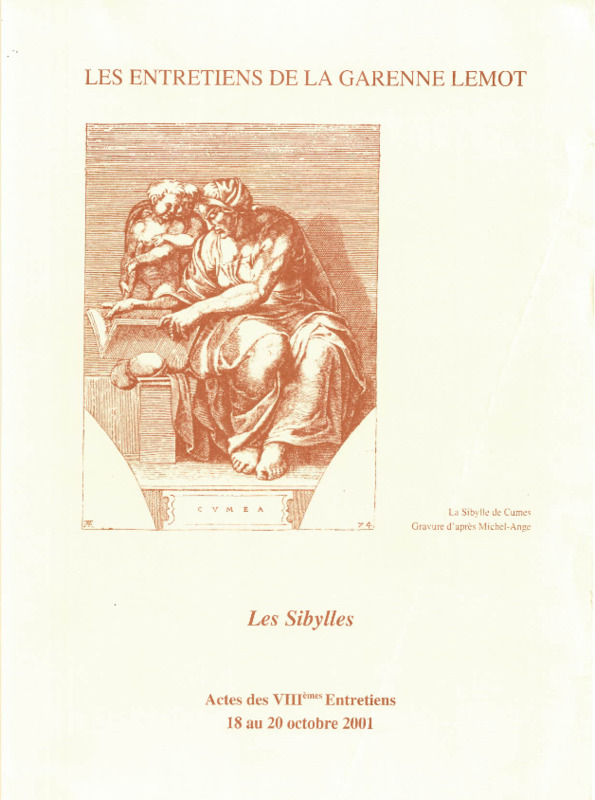
- Titre
- VIII. Les Sybilles
- Droits
- Université de Nantes
- Type
- Actes de colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 2005
- Description
-
"L’Autre, c’est aussi la femme, selon la formule de Mademoiselle de Lespinasse : « L’homme n’est peut-être que le monstre de la femme, et la femme le monstre de l’homme . » Norme ou exception ? Tout se renverse quand quelque chose « se monstre », est à la fois montré et monstrueux. Jackie Pigeaud suit la règle qu’il a fixée en nous livrant un portrait très concret de la sibylle à travers le De Sibylla de Pierre Petit (1686), lequel s’intéresse, de fait, moins à la Sibylle de Cumes – celle de Virgile – qu’à la Sibylle d’Erythrée. Retirement dans la solitude des bois et des cavernes, chasteté, mélancolie, mais aussi inspiration, chant et prophétie. La voix rauque des Sibylles fait penser à la ventriloquie qui fascine Jackie ; mais sa « voix folle », comme le notait déjà Héraclite, – une voix qui semble venir des profondeurs chtoniennes – traverse les siècles. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.164"| - Format
-
- Ouvrage format A4
- 231 pages
- 16 interventions
- 2 interventions non publiées -
 08_0_Table des matières
08_0_Table des matières
- _________________
-
- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « A propos des Sibylles : la connaissance de Dieu, l’extase et les extra-lucides »,
p.7-25. -
 08_1_Alain_MICHEL_A propos des Sybilles : la connaissance de Dieu, l'extase et les extra-lucides
08_1_Alain_MICHEL_A propos des Sybilles : la connaissance de Dieu, l'extase et les extra-lucides
- - Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Des Sibylles mythographiques à la Sibylle de Panzoust », p. 27-36.
-
 08_2_Pierre_MARECHAUX - La Sybille de Panzoust et la fiction du commentaire
08_2_Pierre_MARECHAUX - La Sybille de Panzoust et la fiction du commentaire
- - Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Remarques sur les représentations de Sibylles dans l’art italien », p. 37-47.
-
 08_03_Edouard_POMMIER - Notes sur la représentation des Sibylles dans l'art italien
08_03_Edouard_POMMIER - Notes sur la représentation des Sibylles dans l'art italien
- - Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Sur un tableau d’Antoine Caron », p. 49-53 (illustration).
-
 08_4_Yves_HERSANT - Notule, sur un tableau d'Antoine Caron
08_4_Yves_HERSANT - Notule, sur un tableau d'Antoine Caron
- - Michel Delon, Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIIe) : « Corinne et la Sibylle, ou de l’engagement à la mélancolie", p. 57-65.
-
 08_5_Michel_DELON - Corrine et la Sibylle ou de l'engagement à la mélancolie
08_5_Michel_DELON - Corrine et la Sibylle ou de l'engagement à la mélancolie
- - Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du génie féminin : Corinne ou ‘La Sybille triomphante’», p. 67-82 (illustrations).
-
 08_6_Baldine_SAINT-GIRONS - Du génie féminin
08_6_Baldine_SAINT-GIRONS - Du génie féminin
- - Jean-Yves Boriaud, Université de Nantes (latin) : « Les Sibylles et la Renaissance romaine », p. 83-91.
-
 08_7_Jean-Yves-BORIAUD - Les Sibylles et la renaissance romaine
08_7_Jean-Yves-BORIAUD - Les Sibylles et la renaissance romaine
- - Philippe Heuzé, Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (latin) : « La Sibylle selon Virgile », p.93-98.
-
 08_8_Philippe_HEUZE - La Sibylle selon Virgile
08_8_Philippe_HEUZE - La Sibylle selon Virgile
- - Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Lactance et les oracles sibyllins », p. 99-106.
-
 08_9_ Etienne WOLFF - Lactance et les oracles sibylliens
08_9_ Etienne WOLFF - Lactance et les oracles sibylliens
- - Anna-Maria Babbi, Université de Vérone (philologie romane) : « La Sibylle dans les traductions françaises du ‘Guerrin Meschino’ », p. 107-121.
-
 8_10_Anna-Maria_BABBI_La Sibylle dans les traductions françaises du "Guerrin Meschino"
8_10_Anna-Maria_BABBI_La Sibylle dans les traductions françaises du "Guerrin Meschino"
- - Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Révéler ce qui doit devenir l’évidence ! Postures de la découverte mathématique à l’âge classique », p. 123-150.
-
 08_11_Jean_DHOMBRES - Révéler ce qui doit devenir l'évidence ! Postures de la découverte mathématique à l'âge classique
08_11_Jean_DHOMBRES - Révéler ce qui doit devenir l'évidence ! Postures de la découverte mathématique à l'âge classique
- - Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « A la croisée des chemins de la culture antique et de la tradition andalouse : les rencontres de Federico Garcia Lorca avec la Sibylle-Sphinx », p. 151-172.
-
 08_12_Jocelyne_AUBE-BOURLIGUEUX - A la croisée des chemins de la culture antique et de la tradition andalouse : les rencontres de Federico Garcia Lorca avec la Sibylle-Sphynx
08_12_Jocelyne_AUBE-BOURLIGUEUX - A la croisée des chemins de la culture antique et de la tradition andalouse : les rencontres de Federico Garcia Lorca avec la Sibylle-Sphynx
- - Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « Portrait de l’artiste en Sibylle», p. 173-178.
-
 08_13_Philippe_JUNOD - Portrait de l'artiste en Sibylle
08_13_Philippe_JUNOD - Portrait de l'artiste en Sibylle
- - Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « La Sibylle de Pierre Petit », p. 179-190.
-
 08_14_Jackie_PIGEAUD - La Sibylle de Pierre Petit
08_14_Jackie_PIGEAUD - La Sibylle de Pierre Petit
- - Pierre Brunel, Institut Universitaire de France, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature comparée) : « La figure claudélienne de la Sibylle », p. 191-201.
-
 08_15_Pierre_BRUNEL_La figure claudélienne de la Sibylle
08_15_Pierre_BRUNEL_La figure claudélienne de la Sibylle
- - Jean-Michel Roessli, Université de Fribourg, Suisse (théologie) : « Le VIe livre des Oracles Sibyllins», p. 203-230.
-
 08_16_Jean-Michel_ROESSLI - Le VIe livre des Oracles sibyllins
08_16_Jean-Michel_ROESSLI - Le VIe livre des Oracles sibyllins
-
_________________
Interventions non publiées :
- Brenno Boccadoro, Université de Genève, Suisse (musicologie) : « Les "Sibylles" de Lassus ».
- Andrea Emiliani, Academia dei Lancei, Bologne, Italie, Inspecteur honoraire des Musées : « La Sibylle de Giovanni Baglione ».
_________________ - Editeur
- Université de Nantes
- Contributeur
-
L'Institut Universitaire de France
Modernité de l'Antique
Le C.R.I.N.I.
Le Département de Lettres Anciennes de l'Université de Nantes
Avec le concours du Conseil Général de Loire Atlantique, du District de l'Agglomération nantaise et de la Mairie de Nantes
- Collections
- Publications : Université de Nantes
IX. La (Les) Grâce(s)
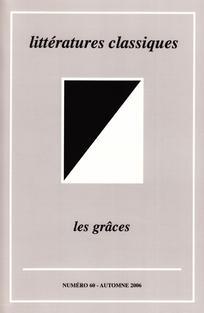
- Titre
- IX. La (Les) Grâce(s)
- Droits
- Revue de Littérature classique, Les Grâces
- https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques1.htm
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 2006
- Description
-
"La Grâce, les Grâces. L’'incipit' est de nouveau une merveille : on part d’un « unisson enchanteur » chez Füssli pour rencontrer aussitôt Vénus dont le nom serait issue du verbe latin 'venire' : celle qui arrive, miroitante, dans l’air printanier, suscitant l’éclosion des fleurs, le rire des flots, le chant des oiseaux, comme dans l’hymne à Vénus qui ouvre le "De natura rerum" :
"Mère des Énéades, plaisir des hommes et des dieux,
Vénus nourricière, sous les astres glissants du ciel,
Toi qui peuples la mer porte-nefs, la terre porte-fruits,…"
Tel est le moment de la paix, de la 'galènè', sur lequel Jackie Pigeaud revient une nouvelle fois dans l’article qu’il consacre à « La grâce épicurienne » : « La lumière éclatée de la mer », le 'poikilletai' des Grecs, le 'variatur' des Romains. « La grâce est une atmosphère », écrit-il. Elle enveloppe et donne voix : sourire innombrable des flots, calme ensoleillé. Mieux que le plaisir, peut-être, ce serait la grâce qui exprimerait l’idéal épicurien.
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.164-165"| - Format
-
- 326 pages
- 23 interventions (18 retranscrites)
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « Grâce, grâces » -Introduction, p. 5-9.
_________________
I. Fécondité d’un antique héritage
- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « La Grâce et la grâce », p.13-25.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « La grâce épicurienne », p. 27-38.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Sur une interprétation de la figure des Grâces », p. 39-48.
- Philippe Junod, Université de Lausanne, Suisse (histoire ancienne) : « De la trinité des Grâces à la fraternité des Arts », p49-60.
- Pierre Brunel, Institut Universitaire de France, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature comparée) : « Grâce(s) noire(s). Au sujet de Baudelaire et Senghor », p. 61-72.
_________________
II. De quelques grâces figurées
- Anne Rolet, Université de Nantes (latin) : « Des délais de l’intervention divine : grâce et salut dans deux emblèmes d’Achille Bocchi (Bologne, 1555) », p. 75-94.
- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « La Manne de Poussin ou la Grâce sans la grâce », p. 95-103.
- Christophe Henry, Deutsches Forum für Kunstgeschichte : « La grâce comme système poético-politique – Pour une lecture des Grâces de Carle Vanloo (1765) », p. 105-134.
- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Autour du trois des trois Grâces et du trois pour faire égalité », p. 135-166.
_________________
III. De la Grâce et du Sublime
- Giovanni Lombardo, Messine, Italie, (grecque) : « Grâce, sublime et deiotes dans le traité "Du style" de Démétrios », p.169-187.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « De la grâce au sublime », p. 189-207.
- Pascal Griener, Université de Neuchâtel, Suisse, (histoire de l’art) : « La grâce de l’historien – Edward Gibbon au Campo Vaccino », p. 209-225.
_________________
IV De la règle à l’exception : modes de la grâce
- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « L’artiste, figure de la grâce à la Renaissance », p. 229-240.
- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Modalités de la grâce selon Baltasar Graciàn », p. 241-250.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève, Suisse (musicologie) : « "Entis affectus transvolans per omnia praedicamenta". La beauté et le nombre dans la querelle entre Jérôme Cardan et Jules-César Scaliger », p. 251-267.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Les Lumières et le droit de grâce », p. 269-312.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : De la Grâce créatrice dans le romance ‘St Gabriel (Séville)’ de Federico Garcia Lorca », p. 313-341.
-
_________________
Interventions non publiées (parution tardive) :
_________________
- Jean-Yves Boriaud, Université de Nantes (latin) : « La grâce des Jésuites ».
- Michel Delon, Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIIe) : « L'opposition entre grâce et beauté dans le portrait romanesque (entre classicisme et romantisme) ».
- Philippe Heuzé, Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (latin) : « Grâces et Charithes dans l’art pompéien ».
- Colette Nativel, Paris I (latin, histoire de l’art) : « La grâce et les grâces dans la peinture d'Europe du Nord ».
- Jean-Michel Roessli, Université de Fribourg, Suisse (théologie) : « Le débat sur la grâce et la liberté aux IVème et Vème siècles ».
_________________ - Editeur
- Revue Littératures classiques
- Revue Littératures classiques, n°60 : La (les) Grâce(s) | 9èmes entretiens
- Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
- Collections
- Publications : Revue Littératures Classiques
X. L'eau, les eaux.
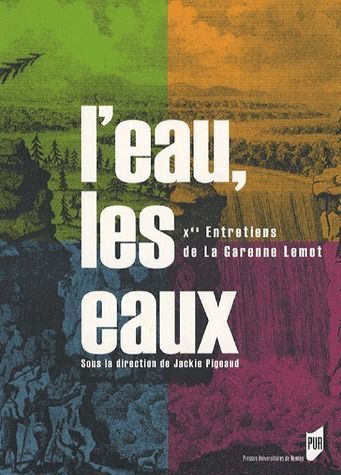
- Titre
- X. L'eau, les eaux.
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Université de Nantes
- Date
- Publication des Actes : 31 août 2006
- Description
-
"Jamais sans doute ces Entretiens n'ont été aussi fluides. Est-ce le sujet ? Libre, l'eau. Créer des séquences, c'est construire des digues et des barrages. Ces Xes Entretiens doivent être lus dans le courant qui fut le leur."
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"Jackie Pigeaud avait si merveilleusement évoqué la galènè dans les Entretiens sur les Voyages et sur la Grâce qu’on se demandait ce qui lui resterait pour les Entretiens sur les eaux. Aussi bien quitte-t-il l’eau étale pour celle qui ruisselle, apparaît et disparaît, en s’appuyant sur le Mundus subterraneus d’Athanase Kircher (1664) et sur les Dissertationes de admirandis Mundi cataractis d’Herbinius (1670). Les illustrations sont saisissantes. De là le problème de la poésie scientifique que Jackie Pigeaud continue à élaborer dans les entretiens suivants.""
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.165"| - Format
-
- 256 pages
- 16 interventions
_________________ -
- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « L’eau et la poétique de la création », p. 11-18.
- Frédéric Le Blay, ancien élève de l’ENS, doctorant Université de Nantes (latin) : « La source mystérieuse de Pline le Jeune : percer les secrets de la nature », p. 19-32.
- Céline Flécheux, École Nationale Supérieure d'Arts de Nancy (philosophie) : « La vague : Courbet et la photographie », p. 33-51.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Du cheminement poétique de Federico Garcia Lorca vers les "Méditations et allégories de l’Eau" », p. 53-71.
- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « La beauté et la tempête. Aspects de la mer à la Renaissance », p. 73-87.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « L’eau dans la vie et la pensée de Pétrarque », p.89-98.
- Claude Imbert, Université de Paris IV- Sorbonne (philosophie) : « Delacroix : Le radeau, la méduse, la girafe », p.99-108.
- Françoise Graziani, Paris VIII (littérature française) : « Les muses et l’eau », p. 107-116.
- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « La glaciation des mots. Rabelais et la lecture biblique », p. 117-128.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du sublime de la tempête », p.129-145.
- Pierre Brunel, Institut Universitaire de France, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature comparée) : « Water Musics : Musiques sur l’eau, Musique de l’eau », p. 147-163.
- Nadeije Laneyrie-Dagen, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris (histoire de l’art) : « De Sienne à Gand : La peinture des fleuves à la fin du Moyen-Âge », p. 165-180.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Eaux douces/eaux salées ; fécondité et corruption des Etats », p. 181-204.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine) : « Cataractes et résurgences », p. 205-220.
- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « L’eau sous la langue et autres arabesques », p.221-244.
- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Quelques réflexions sur les gouttes », p. 245-251.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.32599
XI. La couleur. Les couleurs.
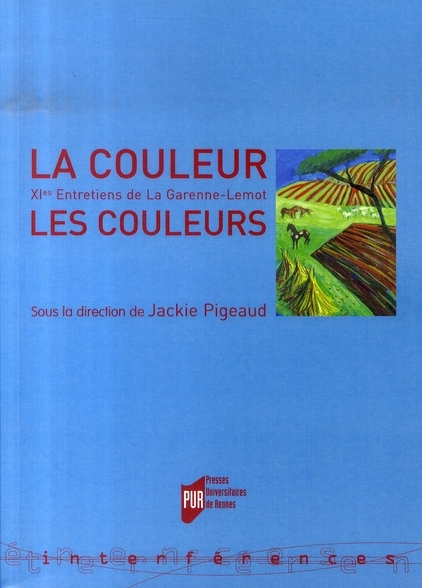
- Titre
- XI. La couleur. Les couleurs.
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2007
- Description
-
La couleur... Les couleurs dans leur variété et leur variation. On revient toujours au poikilon grec, au miroitement du monde. Sujet redoutable, mais qui sollicite l'imagination. Sujet inépuisable, mais le but de ces Entretiens est l'invention, l'explication, dans la liberté. La couleur, la lumière, l'éblouissement, l'émerveillement, mais aussi les noirs, les gris ; mais aussi la rencontre de la forme et de la couleur, et naissent les problèmes esthétiques.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"L’ouverture de Jackie Pigeaud aux "Entretiens" sur la couleur est consacrée à l’étude des différences entre le 'poikilon' grec et la 'varietas' latine, principalement chez Lucrèce. Dans la 'varietas' on peut distinguer différentes composantes : 'varietas' est un terme de peintre. Comme les atomes ou semences du monde sont sans couleurs, les couleurs n’existent pas en soi, mais naissent des formes et d’un « jet de lumière ». Ainsi « n’importe quelle couleur peut se changer en n’importe quelle couleur » (II, 749).
L’article de ces "Entretiens" est consacré au "Torse en plâtre" de Matisse ; et Jackie s’y révèle critique d’art en explorant à l’aide de Roger de Piles et de Bredekamp les rapports de la forme et de la couleur. C'est là qu’il commente la célèbre formule de Matisse : « Dessiner dans la couleur », qu'il parle de la statuaire comme de « peinture épaissie » et qu’il en revient à la 'suggeneia', c’est-à-dire à « une communauté de naissance, une parenté biologique » entre peinture et sculpture, toutes deux nées de la délinéation d’une ombre dans le mythe de la jeune Corinthienne. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.166"|
- Format
-
- 257 pages
- 19 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture », p. 13-16.
- Alain Michel, Professeur Honoraire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Membre de l’Institut : « Les couleurs de la rhétorique et la rhétorique des couleurs », p. 17-28.
- Jean Dhombres, CNRS, Centre Koyré, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (histoire des mathématiques et des sciences) : « Les couleurs du point, les pointillés de la ligne et les ombres des figures », p. 29-54.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « La Mothe Le Vayer – un sceptique au pays des couleurs», p. 55-79.
- Edouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « Notes sur la couleur dans la littérature artistique de la Renaissance en Italie », p. 81-90.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Les couleurs dans le "Satyricon" de Pétrone et les "Épigrammes" de Martial. », p. 91-102.
- Filippo Fimiani, Université de Salerne, Italie (philosophie) : « "Die Gespräche, taggrau". De la poésie et de la peinture chez Paul et Gisèle Celan », p. 103-119.
- Christian Gardair, artiste-peintre, Paris/Berson : « Couleurs/Sublimations – ‘… Les Couleurs du Temps…’ », p. 121-124.
- Philippe Heuzé, université de Paris III-SorbonneNouvelle (latin) : « Le poulain vert. Sur un passage d’Aulu-Gelle (II,26) et de Virgile ("Géorgiques" III, 81-82) ou Des mots et des couleurs », p. 125-130.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Du fragmentaire voyage onirique de Federico García Lorca vers les couleurs-sons du "Pays de Nulle Part". », p. 131-147.
- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Les couleurs de la musique », p. 149-157.
- Frédéric Le Blay, ancien élève de l’ENS, doctorant Université de Nantes (latin) :
« Les couleurs d’Hélène : éloge de la bigarrure », p. 159-168.
- Yves Hersant, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (philosophie de la Renaissance) : « La couleur de l’ombre », p. 169-177.
- Nadeije Laneyrie-Dagen, ENS rue d’Ulm, Paris (histoire de l’art) : « Le bleu des primitifs », p.179-193.
- Caroline Combronde, Université de Louvain, Belgique (esthétique et philosophie de l’art) : « Luministes et clair-obscuristes. De la couleur à la lumière au XVIIe siècle », p. 195-214.
- Michel Delon, Université de Paris IV-Sorbonne (Littérature française du XVIIIe siècle) : « Les couleurs du corps. Roman pornographique et débats esthétiques au XVIIIe siècle », p. 215-224.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « A propos du "Torse en plâtre" de Matisse », p. 225-234.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Du sublime de la blancheur», p. 235-244.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève, Suisse (musicologie) : « Crase, proportion, chromatisme dans la théorie musicale du Cinquecento », p. 245-257.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, du conseil général de Loire-Atlantique, du conseil régional des Pays-de-la-Loire, et de la mairie de Nantes.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.29159
XII. Les Arts, quand ils se rencontrent

- Titre
- XII. Les Arts, quand ils se rencontrent
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
-
Publication des Actes : 2009
_________________ - Description
-
Ces XIIes entretiens de La Garenne-Lemot sont consacrés à la rencontre entre les arts. On y croise par exemple Pétrone, Dante, Frederico García Lorca et Dalí, Derek Walcott, Schoenberg et Kandinsky... Loin de tout dogmatisme, le lecteur est invité, comme les historiens de l'imaginaire que ces Entretiens rassemblent, à prendre les chemins des disciplines, à les regarder se rencontrer.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"L’ouverture des "Entretiens" sur "Les arts, quand ils se rencontrent" est consacrée à l’analyse de la formule de Pline 'Ars se ipsa distinxit' que Jackie Pigeaud traduit : « L’art apporta en lui de la distinction ». Distinguer signifie à la fois séparer et peindre, c’est-à-dire colorer, paysager, « varier », unir le trait et la couleur, comme en témoignent Horace ou Lucrèce. Curieusement, le même vocabulaire technique convient à tous les arts, désignant des problèmes analogues, ainsi que le montre Horace en explicitant son 'ut pictura poesis'.
L’ouverture de Jackie est latine ; son article, lui, est grec, et constitue un puissant commentaire de "La Poétique" d’Aristote, centré sur une traduction de la 'mimésis' comme production, fabrication, en même temps que reproduction, permettant la reconnaissance. De fait, « imitation, représentation ne rendent pas assez compte – à cause de l’usure des termes sans doute – du travail, de l’exécution que suppose la 'mimésis' ». La 'technè' mime la nature, mais « la véritable imitation se situe hors du champ de la conscience de celui qui mime » (p. 33). En ce sens, la 'mimésis' esthétique n’est qu’un cas particulier des techniques qui, toutes, relèvent, de la 'physis'. Le rythme est, lui aussi, comme une mise en forme qu’on doit à la nature. Et Jackie Pigeaud de rappeler avec Aristote que la poésie est « le fait d’un homme bien doué ou d’un fou ». « Il est en effet vraisemblable qu’il se produise de l’invraisemblable ». Le paradoxe est là.
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.166-167"| - Format
-
- 296 pages
- 21 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture – 'Ars se ipsa distinxit' (Pline, HN, XXXV, 29 », p. 13-19.
- Alain Michel, Membre de l’Institut, Professeur émérite de l’Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « La rencontre des arts : unité, histoire, beauté », p. 21-29.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « De la parenté entre les arts – quelques remarques sur la "Poétique" d’Aristote », p.31-44.
- Frédéric Le Blay, Université de Nantes (latin) : « Portrait du Philosophe en artiste, ou de la Philosophie considérée comme l’un des Beaux-Arts », p. 45-59.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Quelques aspects du discours sur l'art chez Pétrone », p. 61-69.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle (latin) : « Souffler n’est pas chanter », p.71-75.
- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « La vie de plaisirs ou une esthétique d’art total dans l’Espagne musulmane du XIe siècle », p. 77-89.
- Françoise Graziani, Université de Paris VIII-Vincennes-Saint Denis (philosophie) : « Figurer et dire : la peinture parlante, p. 91-98.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine (grec) : « Dante et l’'ekphrasis' sublime. Quelques remarques sur le ‘visibile parlare’ ("Purg". X 95) », p. 99-119.
- Édouard Pommier, Inspecteur général honoraire des Musées de France : « La "Rencontre des Arts" et son image dans l’Italie de la Renaissance », p. 121-134.
- Yves Hersant – EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Peinture et théâtre dans l’Italie renaissante », p. 135-141.
- Nadeije Laneyrie-Dagen, ENS, rue d’Ulm, Paris (histoire de l’art) : « Regards croisés sur la gymnastique antique : l’écrivain, le graveur, le peintre », p. 143-155.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « L’harmonie ou le dialogue des arts dans la pensée politique, de Seyssel à Louis XIV », p. 157-182.
- Yves Touchefeu, Classes Préparatoires, Nantes : « 'Ut musica pictura' ? Jean-Jacques Rousseau et le clavecin oculaire du Père Castel », p. 183-192.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X Nanterre (philosophie) : « Pierre Kaufmann : Arts de l’espace et dimension de la destinée », p. 193-204.
- Annie Gutmann, Médecin Psychiatre : « Chorégraphie du paysage », p. 205-219.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « L’"Ode à Salvador Dali" de Federico García Lorca (1926) : ou de la rencontre artistique de la poésie et de la peinture », p.221-243.
- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Allusions ou illusions d’Espagne : la cartographie imaginaire d’"Iberia" d’Albéniz, une contestation du paragone traditionnel », p.245-253.
- Brigitte Van Wymeersch, Université de Louvain (musicologue) : « Schoenberg et Kandinsky : une certaine idée de la création et de la relation entre les arts », p. 255-271.
- Pierre Sullivan, Psychanalyste : « La synthèse des arts : "Le chien de Tiepolo" de Derek Walcott : poésie et peinture », p. 273-286.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno (philosophie) : « Le hier jouer – corps, images, événements », p.287-296.
_________________ - Editeur
- Presses Universitaires de Rennes (PUR)
- PUR : Les arts, quand ils se rencontrent | 12èmes entretiens
- Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.39537
XIII. Métamorphose(s)
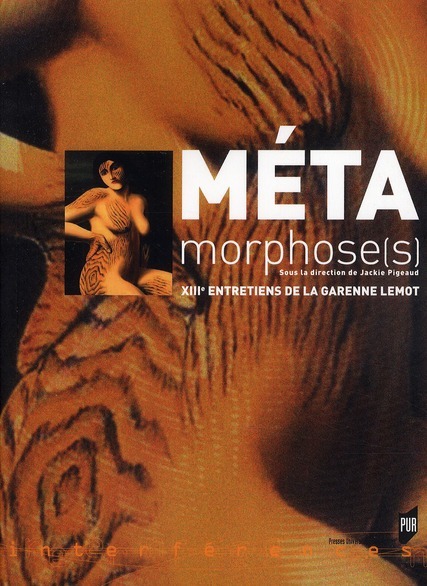
- Titre
- XIII. Métamorphose(s)
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2010
- Description
-
Ces XIIIes entretiens de La Garenne-Lemot sont consacrés aux métamorphoses. Y sont évoqués par exemple Hans Bellmer, Munch et Strindberg, Ovide et Kafka, Giordano Bruno, György Kurtág ou Federico García Lorca... Loin de tout dogmatisme, le lecteur est invité, comme les historiens de l’imaginaire que ces entretiens rassemblent, à prendre les chemins des disciplines, à les regarder se rencontrer.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"Nous ne pouvions éviter de consacrer un entretien à la métamorphose. Comment rendre compte du temps de l’effectuation, du passage entre deux états, de l’être mixte en voie de constitution ? Jackie Pigeaud affirme ses talents de critique d’art en analysant l’œuvre de Hans Bellmer, son sens de l’'harmogè', « jointure », et sa relation avec ce qu’il appelle « l’inconscient physique » et pas seulement culturel."
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.166-167"|
_________________ - Format
-
- 376 pages
- 20 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « Ouverture », p. 13-16.
- Alain Michel, Membre de l’Institut, Professeur émérite de l’Université de Paris IV-Sorbonne (latin) : « La métamorphose d’Ovide à Kafka », p. 19-25.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine (grec) : « La métamorphose dans la "Divine Comédie" de Dante », p. 27-49.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Roi et tyran, jeux de métamorphoses. Chateaubriand, Constant et Tocqueville face aux Césars modernes », p. 51-89.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « De certaines ‘Métamorphoses canines’ étranges aux frontières de la vie et de la littérature, chez Federico García Lorca après Miguel de Cervantes : ou du "Coloquio de los perros" à "Poeta en Nueva York" », p. 91-130.
- Yves Touchefeu, Classes Préparatoires, Nantes : « Métamorphoses sur le Parnasse Galant : jeux littéraires de Charles Perrault », p. 131-142.
- Françoise Graziani, Université de Paris VIII-Vincennes-Saint Denis (philosophie) : « Métamorphoses poétiques », p. 143-152.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « La métamorphose d’un genre : de l’épigramme à l’énigme, l’exemple de Symphosius », p. 153-164.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Giordano Bruno et la métamorphose», p. 165-174.
- Mariafranca Spallanzani, Université de Bologne (philosophie) : « Métamorphoses de l’ordre. Les dentelles du philosophe et le métier à bas de l’Encyclopédiste », p. 175-195.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X Nanterre (philosophie) : « Ach, daß ich Nacht wäre ! », p.197-211.
- Jean Dhombres, CNRS (histoire des mathématiques) : « La trajectoire d’une parabole. Métamorphoses de la philosophie naturelle sous l’effet des mathématiques », p. 213-241.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « Transformer l’harmonie en Grèce au cinquième siècle avant notre ère », p. 249-263.
- Grégroire Tosser, Université de Nantes (musicologie) : « Réécriture et métamorphose de la forme musicale dans les programmes composés de György Kurtág », p. 265-284.
- Pierre Maréchaux, Université de Nantes (latin) : « Nemo à Carnegie Hall : transcriptions, paraphrases et métamorphoses dans le pianisme germano-slave des XIXe et XXe siècles », p.285-296.
- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « Les métamorphoses animales dans l’islam populaire médiéval et moderne », p. 297-311.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle (latin) : « L’arbre, le corbeau et l’hermaphrodite », p. 313-317.
- Clélia Nau, Université de Paris 8 (philosophie) : « Fleurs de métamorphose : Munch et Strindberg à l’école d’Ovide », p. 319-339.
- Jackie Pigeaud, Université de Nantes, Institut Universitaire de France (latin, histoire de la médecine): « La métamorphose. Hans Bellmer », p. 341-351.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno (philosophie) : « La lutte immobile. Matières, métamorphoses et dialectique de l’image », p. 353-372.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire et la Société Générale de Nantes.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.40005
XIV. Nues, Nuées, Nuages

- Titre
- XIV. Nues, Nuées, Nuages
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 9 octobre 2010
- Description
-
"Ce qui est frappant dans cette moisson de nuages, c'est l'intention descriptive des poètes et des peintres, comme des mathématiciens et des philosophes : la poésie n'est pas le domaine du flou et de l'à-peu-près. Le nuage, si souple et si changeant peut nous terrifier comme nous séduire. Il fait évidemment partie de notre imaginaire commun ; apte aux formes les plus diverses, les plus subtiles et les plus grotesques. Comme l'écrit Sénèque : «Personne n'est à ce point engourdi, stupide et courbé vers la terre pour ne pas relever la tête vers le ciel et se redresser avec toute son âme, surtout quand il y voit briller quelques merveilles neuves» (Q.N. VII,1)."
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
""Nues, Nuées, Nuages. Jackie Pigeaud montre comment c’est le désir de précision qui rend un sujet poétique. En témoigne Lucrèce, chez lequel les nuages constituent des personnages essentiels dans le grand orchestre de la nature. Vus à travers une flaque d’eau, ils font croire qu’on les voit en-dessous de soi ; leur consistance se situe quelque part entre le bois et la fumée ; et les sons qu’ils émettent sont d’une diversité étonnante : crépitement, craquement, claquement, grincement, chuintement, comme d’un fil déroulé à partir d’une bobine, etc. ""
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.159-167"| - Format
-
- 327 pages
- 22 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, Professeur émérite de l’Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Ouverture », p. 13-15.
- Alain Michel, Membre de l’Institut, professeur émérite de l’Université de Paris IV – Sorbonne (latin) et Arlette Michel, professeur émérite de l'université Paris IV-Sorbonne (français) : « Baudelaire et les nuages : l’image, la forme et l’absolu », p. 17-25.
- Françoise Graziani, Université de Paris 8 (littérature comparée) : « "Caligare Animis" : Nuées, brumes et voiles poétiques », p. 27-37.
- Giovanna Pinna, Università degli Studi del Molise, Campobasso, Italie (germaniste) : « Météorologie poétique : les nuages chez Goethe », p. 29-50.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin) : « ‘Per nubila lunam’. Effets de nuages chez Virgile », p. 51-56.
- Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, Professeur émérite de l’Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Remarques sur les nuages de Lucrèce », p. 57-71.
- Frédéric Le Blay, Maître de conférence, Université de Nantes (latin) : « Nuages et miroirs : à propos des "Questions sur la nature" de Sénèque », p. 73-83.
- Yves Touchefeu, Professeur de classes préparatoires, Lycée Guist’hau, Nantes (lettres classiques) : « Les Nuées dans les "Nuées" d’Aristophane », p. 85-95.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Quelques emplois de 'nebula, nimbus, nubes' et de leurs dérivés », p 97-101.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (philosophie) : « Les nuages dans la "Divine Comédie" de Dante », p. 103-114.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Des avatars et métamorphoses précoces du 'Nuage porteur d'eau féconde', dans la poésie de Federico García Lorca », p. 115-148.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « ‘Mourir joyeusement pour ces deux nuées : la justice et la vérité’. L’exemple d’Albert Thibaud », p. 149-165.
- Jean Dhombres, CNRS (histoire des mathématiques) : « La raison graphique à l’épreuve des gouttes de pluie, des vents et des nuées », p. 167-191.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Nuages de Léonard », p. 193-199.
- Baldine Saint Girons, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Les nuages dans la peinture chinoise et occidentale, 1ère partie », p. 201-211.
- Yolaine Escande, EHESS (spécialiste de la peinture chinoise) : « Les nuages dans la peinture chinoise et occidentale, 2ème partie », p. 213-232.
- Nadeije Laneyrie Dagen, Ecole Normale Supérieure, rue d’Ulm, Paris (histoire de l’art) : «Corrège, la nuée et la volupté », p. 233-248.
- Céline Flécheux, Ecole des Beaux-Arts de Nancy (philosophie) : « Le nuage percé ou la représentation de la pluie en photographie et en peinture », p. 249-257.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Mémoires d’air. Morphologies, genèses et généalogies visuelles au XXe siècle », p. 259-284.
- Emilie Bouvard, Université de Paris I – doctorante (histoire de l’art) : « Mathieu Verlier : envisager les nuages », p. 285-289.
- Pauline Duclos-Grenet, histoire de l’art (master – Dijon, ENS rue d’Ulm) : « Les nuages dans la miniature parisienne du XVe siècle ou splendeur et misère de la miniature », p. 291-300.
- François Clément, Université de Nantes (arabe), « ‘Que vois-tu ? Je vois du noir rougeâtre que déchire un éclair’ ou "Les nuages" d’Ibn Durayd : tableaux du ciel et de la langue », p. 301-311.
Annexe : Ibn Durayd, « La pluie et les nuages », p. 311-327.
_________________
- Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire et la Société Générale de Nantes.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.38558
XV. Miroirs
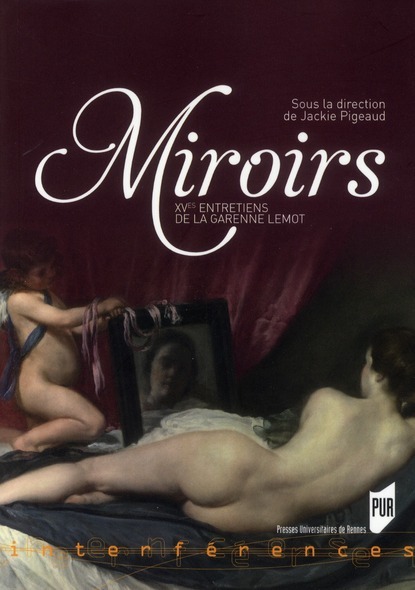
- Titre
- XV. Miroirs
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2011
- Description
-
"A partir de 2008, Jackie Pigeaud nous a invités à réfléchir plus systématiquement à quatre types d’outils que nous utilisons plus ou moins spontanément et qui sont des modes très efficaces à la fois de connaissance et de création : la réflexion spéculaire, le travail sur la limite, l’instauration d’un rythme, le retour à l’origine. Prendre conscience de la nécessité de manier ces outils, c’est aussi sentir la nécessité où se trouve la pensée de partir de combinaisons de forces plutôt que de forces isolées. Ainsi fait-on du miroir une entité rigide, si on ne pense pas à la diversité des images spéculaires qu’il fournit, aux changements d’angle, de dimension, d’éclairage qu’il permet. La limite, aussi, se découvre d’une complexité fascinante, visible ou invisible, réelle ou imaginaire, objet de croyance ou imposition forcée. Tout se dialectise, si, loin de se précipiter vers un faire aveugle, on se soucie de ce qui nous meut, de la véritable provenance. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.167.
_________________
Les vingt-deux études publiées ici explorent, chacune à leur manière et sur un objet singulier, l’ambiguïté des miroirs : à la fois leur dimension critique et leur puissance de fascination ; à la fois la vertu de leur éclat ou de leurs images et la perversion de leurs reflets ou de leurs simulacres. De l’antiquité à l’époque contemporaine et dans tous les champs du savoir comme des pratiques, les miroirs sont des instruments de connaissances et de rêves ; de vérité, de beauté et d’illusion ; de splendeur et d’obscurité.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"Les Miroirs, nous rappelle Jackie Pigeaud dans son "Ouverture", ne sont pas seulement centraux pour la connaissance de soi : ils en sont l’instrument, dans la mesure même où ils introduisent une scission qui permet la comparaison. Si Tirésias avait prédit que Narcisse n’atteindrait la vieillesse que s’il ne se connaissait pas (si se non noverit), on pourrait dire que Narcisse meurt pour ne pas être parvenu à se connaître : « Le miroir ne fonctionne pas pour Narcisse », écrit, en effet, Jackie Pigeaud. Anticipant les "Entretiens sur La connaissance de soi", il soutient ainsi paradoxalement que « le miroir est plus fort que l’art » et qu’il en est le modèle absolu ; et il s’appuie, sous cette incidence, sur Pline, Sénèque, Galien.
L’article de Jackie Pigeaud qui fait suite à cette « Ouverture » examine les rapports cruciaux entre reflet, trace et œuvre d’art. Poursuivant la réflexion qu’il avait commencé lors des "Entretiens sur la couleur" avec l’œuvre de Matisse, dans laquelle un torse en plâtre trouve son image inversée et complétée comme par « une proposition de vie » dans un tableau à l’intérieur du tableau, il s’interroge sur la fascination qu’exerce la figure du Christ inversée et imprégnée de son sang dans ce véritable miroir textile que constitue le Saint Suaire de Turin. Considérons donc la "Sacra Sindone" comme une œuvre d’art.
Et, pour ne pas nous perdre dans le dédale des textes, prenons pour fil conducteur l’'ekphrasis', la description du Saint Suaire menée par Alfonso Paleotto, publiée à Bologne en 1598. Le Christ lui-même est peintre et réalise une œuvre d’art : en s’auto-présentant, en peignant sa personne en miroir avec son propre sang, il imprime sa figure sur le suaire pour que nous puissions recevoir les stigmates de sa Passion sur nos corps. L’impression reprend alors son sens fort et devient « créatrice d’images », tout comme la 'phantasia' chez Longin."
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.168"| - Format
-
- 397 pages
- 23 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) « Ouverture : Le miroir, la conscience et la connaissance de soi », p. 13-20.
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie), « Un miroir spéculatif : Le frontispice de La "Science nouvelle" de Vico », p. 21-38.
- Françoise Graziani, Université de Paris VIII (littérature comparée), « Le miroir de la sagesse », p.39-53.
- Jackie Pigeaud, Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Le miroir de Dieu. Étude sur la description du Saint Suaire par Alfonso Paleotto, 1599 », p. 55-65.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Miroirs magiques », p. 67-75.
- Jean Dhombres, EHESS, Centre Koyré, Paris (histoire des mathématiques) : « 'Mirum non est mirum', La gauche et la droite au miroir des mathématiques », p. 77-106.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « Visions de l’âme, miroirs et harmonie dans le "Tractatus de Configurationibus qualitatuum et motuum" de Nicole Oresme », p. 107-134.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie) : « L'œuvre miroir : les verrues du tyran », p. 135-146.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Salomon, miroir des princes ? », p. 147-191.
- Frédéric Le Blay, Université de Nantes (latin) : « Miroirs philosophiques : vertus et perversions du reflet de soi », p. 193-203.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre (latin) : « Quelques réflexions sur les miroirs dans la Rome antique et le Moyen Age latin », p. 205-214.
- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « Jeux de miroirs : quelques variations autour du mot arabe mir'ât », p. 215-227.
- Arnaud Maillet, Université de Paris-Sorbonne (histoire de l’art) : « Le miroir d’encre. Images visuelles, images mentales, images littéraires », p. 229-261.
- Didier Laroque, Ecole d’Architecture de Paris Val de Seine (EAPVS) : « Les miroirs de la Villa Palagonia », p. 263-271.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin) : « Au miroir profond des chants amébées. La création spéculaire dans les "Bucoliques" », p. 273-279.
- Alain Michel, Membre de l’Institut, professeur émérite de l’Université de Paris IV – Sorbonne (latin) et Arlette Michel, professeur émérite de l'université Paris IV-Sorbonne (français) : « Le miroir, le rhétorique et l’absolu, p. 281-287.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (philosophie) : « Narcisse au miroir de la traduction. Exercice isométrique sur les "Fragments du Narcisse" de Paul Valéry », p. 289-299.
- Pierre-Louis Reymond, Professeur de classes préparatoires au Lycée Clémenceau, Nantes (arabe) : « Les miroirs de Taha Hussein, romancier et essayiste égyptien, réflexions sur la société de son temps », p. 301-307.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Des reflets de Ana Maria et Savador Dali dans l’écriture en miroir de la « beauté terrifiante » chez Federico Garcia Lorca », p. 309-347.
- Céline Flécheux, Université de Paris VII (histoire de l’art) : « Miroirs et perspective », p. 349-359.
- Clélia Nau, Université de Paris VII (philosophie) : « Miroirs d'eau. Réflexions à partir des "Still Water" de Roni Horn », p. 361-374.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Miroirs incarnés, des images aux affects, et retour », p. 375-388.
- Peter Briggs, sculpteur (Tours) : présentation de l’œuvre ‘Donna Fugata table piece’, dialogue avec Arnaud Maillet, p. 389-397. 2 ill.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire et la Société Générale de Nantes.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.38061
XVI. La Limite.
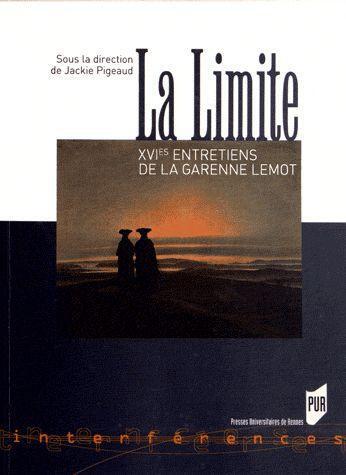
- Titre
- XVI. La Limite.
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2012
- Description
-
Ces Entretiens sont attachés à un lieu qui leur donne son nom : La Garenne Lemot, une villa néo-classique, aux bords escarpés de la Sèvre, dans l'évocation de la Toscane. En cet endroit on peut parler de beauté et de grâce, mais aussi, comme nous l'avons fait, de tolérance et d'amitié. Cette année nous avions choisi la limite comme sujet de nos Entretiens, continuant ainsi à proposer des lieux communs à la réflexion.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"L’objet de l’ouverture des "Entretiens XVI" sur la limite est précisément la peau, le sac de peau, dans lequel je suis enfermé, non pas la peau qui s’imprime sur la 'sindone', comme chez Paleotto. Ma peau, c’est la limite de mon corps propre, le lieu par excellence de la pudeur. Chose étrange, les comédiens peuvent tout faire, mais « se faire rougir, impossible » : voilà qui exige un imprévu. Pourquoi donc l’histologie et la dermatologie se constituent-elles si tardivement en sciences ? Dagognet reprochait à Vésale d’avoir négligé la peau et manqué la révolution copernicienne, en ne sachant pas « retourner l’humain ». De fait, comme le rappelle Jackie Pigeaud, il faut attendre Malpighi et Bichat pour que l’intérieur et l’extérieur échangent leurs valeurs.
Reconnaître ses limites permet d’éviter l’angoisse, en la canalisant. Voilà ce sur quoi revient l’article que Jackie Pigeaud consacre à « La limite épicurienne ». Pas de création 'ex nihilo' chez Lucrèce, pas d’anarchie, puisque « tout met du temps à croître, comme il est juste (ut par est), à partir de semences déterminées » (I, 188-190). La limite se dit finis et elle tient à des pactes de nature ('foedera naturae'). Encore faut-il se rappeler ce que Jackie disait dans l’article sur la tolérance, à savoir que la définition fonctionnait aussi comme exclusion."
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.168-169"| - Format
-
- 318 pages
- 20 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Ouverture », p. 11-19.
- Françoise Graziani, Université de Corse (littérature comparée) : « Limites du monde, limites de la pensée », p. 21-31.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Giordano Bruno, le grand transgresseur», p. 33-41.
- Jackie Pigeaud, Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « La limite dans la pensée épicurienne », p. 43-54.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (Musicologie) : « Limite et transgression dans la théorie musicale antique », p. 55-76.
- Jean Dhombres, EHESS, Centre Koyré (histoire des mathématiques) : « Une déconstruction d’une histoire des limites de François Viète aux ultrafiltres », p. 77-110.
- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « Les bornes et au-delà des bornes : idoles, cités et femmes des confins de l'Univers selon la vision arabe à l'époque médiévale », p. 111-123.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Une habitation fabuleuse », p. 125-141.
- Céline Flécheux, Université de Paris 7 (histoire de l’art) : « L’horizon au temps d’Alberti », p. 143-151.
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France (membre senior), Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Le Ha-Ha ou la limite invisible », p. 153-168.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin) : « Esquisses de beautés aux bords de la limite », p. 169-174.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (philosophie) : « 'Acciò che l’uom più oltre non si metta'. Ulysse et la limite dans la "Divine Comédie" de Dante », p. 175-187.
- Etienne Wolff, Université Paris Ouest (Paris X - Nanterre) (latin) : « Les limites de l’éducation des filles : deux curieuses lettres de Pline le Jeune », p. 189-194.
- Patrick Dandrey, Université de Paris IV Sorbonne (littérature française) : « D’une limite incertaine. L’Hippolyte racinien ou l’adolescence introuvable », p. 195-209.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « ‘A un orme desséché’ (1912) et ‘Peuplier mort’ (1920) : ou l’écriture limite de la maladie d'amour-mélancolie d'absence, chez Antonio Machado et Federico García Lorca », p. 211-233.
- Yvon Le Gall, Université de Nantes (droit) : « Réagir à la tyrannie, variations sur la question des limites», p. 235-260.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie): "Réaliser la limite : un parcours du tracé », p. 261-273.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV-Sorbonne (histoire de l'art contemporain) : « Daguerréotype, mémoire et limites », p. 275-295.
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France (membre junior honoraire), Université de Nantes (latin) : « Fantaisies et sonates dans l’histoire des musiques d’Occident : la limite de deux genres », p.297-311.
- Roberto Festa, directeur de l’ensemble Daedalus : « Finale – Musa latina ou l’invention de l’Antique », p.313-318.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire et la Société Générale de Nantes.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.56495
XVII. L'Arbre

- Titre
- XVII. L'Arbre
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2013
- Description
-
Ces Entretiens sont attachés à un lieu qui leur donne son nom : La Garenne Lemot, une villa néo-classique, aux bords escarpés de la Sèvre, dans l'évocation de la Toscane. En cet endroit on peut parler de beauté et de grâce, mais aussi, comme nous l'avons fait, de tolérance et d'amitié. Cette année nous avions choisi l'arbre comme sujet de nos Entretiens, continuant ainsi à proposer des lieux communs à la réflexion.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"De L’Arbre, Jackie Pigeaud nous déclare 'ex abrupto' qu’il « ne pense pas que nous ayons eu un sujet plus difficile à traiter ». L’arbre est « le plus beau présent fait à l’homme », comme le rappelle Pline l’Ancien : aliments, meubles, vêtements, maisons, outils, nous lui devons tout. Et la question qu’il pose est de savoir comment l’âme et, avec plus d’évidence, encore, la forme, vient au vivant. Pourquoi la nature a-t-elle l’obsession de la distinction ? Afin de découvrir les voies qui engendrent les formes, il importe de « déployer la rêverie » avant qu’elle ne se fige dans des concepts, tels, par exemple, ceux de préformation ou d’épigénèse.
Rapin croyait que les Anciens « ne connaissaient pas la concinnitas, la symétrie ». Voilà une thèse que Jackie Pigeaud nous apprend à mettre en question en nous faisant lire "The Garden of Cyrus" de Thomas Browne (1658), dont la thèse est précisément que « la nature géométrise et observe de l’ordre en toutes choses ». Browne voit partout des losanges, bases de l’ordre en quinconce, qui est à ses yeux le plus beau des ordres ; son goût suit celui de Pline qui vantait les perspectives ouvertes par des rangées de plantations « alignées dans toutes les directions ». De là des considérations sur la lumière et l’ombre qui échangent leurs valeurs, de sorte que la lumière devient paradoxalement « l’ombre de Dieu » dans la nature. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.165-166"| - Format
-
- 425 pages
- 18 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Ouverture », p. 13-21.
Points de vue esthétiques
_________________
- Yolaine Escande, CRAL, EHESS, Paris (littérature chinoise) : « L’Arbre en Chine : l’art de l’inutilité et de l’absence d’action », p. 24-44.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV-Sorbonne (histoire de l’art contemporain), « L’arbre comme ornement, charpente et tuteur dans les théories artistiques (XVIIe-XIXe siècles) », p. 45-83.
- Clélia Nau, Université de Paris 7 Diderot (histoire et théorie de l’art), « 'Einfühlung' et abstraction. L’organicité végétale chez Mondrian », p. 85-100.
- Philippe Heuzé, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin), « De l’arbre au pinceau. Sur quelques peintures pompéiennes », p. 101-110.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Du paysage au visage (pour personne), ou de l’indifférence esthétique », p. 111-128.
_________________
Points de vue philosophiques
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « L’arbre ou le corail : comment imaginer la vie ? », p. 131-144
- Pierre Henri Frangne, Université de Rennes 2 (philosophie) : « L'arbre et l'extériorité », p. 145-160.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Arbor gilpiniana », p. 161-167.
_________________
Points de vue littéraires
_________________
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France (membre junior honoraire), membre correspondant de l’IEA de Nantes, Université de Nantes (latin) : « De l’arbre à l’écorce : l’odyssée herméneutique de la "Genealogia deorum gentilium" de Boccace », p. 171-211.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (philosophie) : « 'Putare' et 'computare' : de l’art d’émonder les arbres à l’art de raconter une histoire », p. 213-228.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « L’Orme du mail et le Platane des Invalides », p. 229-254.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, Université de Nantes (espagnol) : « Federico García Lorca, de Fuente Vaqueros à Grenade : ou les difficiles retrouvailles du musicien-poète avec les arbres de ses premières rencontres oraculaires », p. 255-309.
- François Clément, Université de Nantes (arabe) : « De l’arbre et de la chamaille : autour de la racine arabe SGR », p. 311-323.
_________________
Points de vue symboliques
_________________
- Jackie Pigeaud, Membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « L’Arbre – Les Arbres. De René Rapin à Thomas Brown », p. 327-364.
- Jean Dhombres, EHESS, Centre Koyré, Paris (histoire des mathématiques), « Faut-il chercher à analyser l’usage en mathématiques des mots et des symboles de l’arbre ? », p. 365-392.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « L'arbre harmonique dans la théorie musicale du XVIIIème siècle », p. 393-407.
_________________
Finale
_________________
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - École supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie) : « La fonction symbolique du palmier ou les transformations de la "Phoenix dactylifera"», p. 409-425.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire et la Société Générale de Nantes.
- Identifiant
- DOI : 10.4000/books.pur.53989
XVIII. Le Rythme

- Titre
- XVIII. Le Rythme
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2014
- Description
-
Dans ce volume il est question de musique et de poésie, mais aussi de médecine, de biologie, de mathématiques et de politique. On y trouvera les réflexions de philosophes et d'historiens d'art, l'ensemble des textes permettant de donner un aperçu original sur ce thème du rythme.
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"Après la réflexion spéculaire et les jeux plus ou moins subtils ou brutaux avec la limite, nous avons abordé les problèmes que pose l’instauration d’un rythme conçu non plus comme simple caractère fluent, mais comme « mise en forme de la nature », comme 'metarruthmisai'. Jackie Pigeaud rappelle dans son "Ouverture" qu’il appartint au médecin Hérophile de découvrir le pouls, un pouls qui différait selon les âges de la vie et avait, chaque fois, son propre mètre. De la sorte, le corps entier fonctionnait « comme un poème » avec ses différents types de prosodie. Lysippe aurait, cependant, inventé selon Pline une nouvelle 'summetria' et remplacé le "Canon" de Polyclète par celui de 'kairo's. Avec le 'kairos' se constitue, en effet, une perception particulièrement aiguë du temps qui fait émerger la valeur, comme si le quantitatif et le qualitatif devenaient la même chose.
Dans son article, Jackie nous donne la joie d’une nouvelle traduction de Catulle, en même temps qu’il aborde la question des rapports de la poésie – ou plutôt d’un rythme particulièrement contraignant – avec la folie. Il s’agit du poème 63 sur la transe et l’émasculation d’Attis, prêtre de Cybèle. Comme dans "Les Bacchantes" ou dans "l’Hercule furieux", des actes irréparables sont commis sous l’effet de transes provoquées par la musique. Jackie anticipe la question de l’éveil et imagine même une « histoire des éveils » en posant la question de savoir ce qui vaut mieux : sortir autrui de l’ignorance de son acte et donc d’une forme d’innocence, ou bien l’éveiller pour le plonger dans le malheur. L’article se termine par une suggestive citation de Humboldt sur « le monde en soi» que constitue le rythme.
« Le rythme présente l’obscure palpitation du sentiment et de l’affection avant qu’elle ne se répande en mots ou lorsque la résonance se perd en lui. » C’est « une pure forme, qu’aucune matière n’alourdit, et qui se manifeste dans les sons, donc dans ce qui s’empare le plus profondément de l’âme parce qu’il se tient au plus profond de l’essence de la sensation interne ». Cette sensation interne de soi est ce qui intéressait Jackie depuis toujours et qui prit une place croissante dans les derniers Entretiens. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.165-166"|
- Format
-
- 440 pages
- 23 interventions
_________________ -
- Jackie Pigeaud, Membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Ouverture – La tradition d’Hérophile », p. 13-18.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « ‘La frénésie du jazz qui vient de s'emparer de notre jeunesse se traite avec une bonne dose de plomb’. Regards croisés sur la musique syncopée et le jazz au début du XXe siècle », p. 19-60.
- Yolaine Escande, CRAL, CNRS-EHESS, Paris (littérature chinoise) : « Le rythme du trait comme rythme du monde, principe fondamental de la peinture en Chine », p. 61-75.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV – Sorbonne (histoire de l’art contemporain) : « Rythmes kaléidoscopiques », p. 77-97.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie) : « La navette et la bouse de vache ou l’artiste en tarentule », p. 91-119.
- Céline Flécheux, Université de Paris VII (histoire de l’art) : « Au rythme des pas perdus. Déplacement des pratiques artistiques contemporaines », p. 121-134.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Une main amoureuse. Rêveries, résonances, revenances », p. 135-150.
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « L’inspir, l’expir, le choix d’un rythme », p. 151-163.
- Marianne Massin, Université de Lille 3 (philosophie) : « Le rythme dans la pensée », p. 165-177.
- Jean Dhombres, Centre Koyré, EHESS, Paris (histoire des mathématiques) : « Existe-t-il un tempo de la pensée démonstrative formalisée qui serait différent pour la pensée inventive ? », p. 179-205.
- Bernardino Fantini, Université de Genève, Centre Jeantet d’histoire de la médecine (biologie, médecine) : « Rythmes corporels, rythmes psychologiques, rythmes culturels : la valeur du rythme en biologie, en médecine et en musique », p 207-238.
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France (membre junior honoraire), Université de Nantes, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « La crase musicale contre la pulsation : histoire de quelques dévoiements rythmiques », p. 239-258.
- Pierre Henri Frangne, Université de Rennes II (philosophie) : « Dialectique et rythme de l’œuvre musicale selon Boris de Schloezer », p. 259- 275.
- François Clément, Université de Nantes, CRHIA, Nantes, CESCM, Poitiers (arabe) : « Rythmes arabes. De la scansion temporelle en historiographie », p. 277-287.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « Mézières, Machiavel et Rousseau. Rythme et ressourcement dans la pensée politique », p. 289-311.
- Mariana Saad, Queen Mary University of London, Londres (philosophie) : « Le rythme des crises économiques chez Destutt de Tracy et Fourier », p. 313-324.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « "La Savetière prodigieuse" au théâtre : un exemple du rythme lyrique et dramatique de la lutte contrela mort par la ‘danse des bottines’ chez Federico García Lorca », p. 325-346.
- Philippe Roger, EHESS, Paris (littérature) : « Qu’est-ce donc que le rythme ? Les mises en scènes musicales dans le roman libertin du XVIIIe siècle », p. 347-365.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (lettres classiques) : « Rythme et harmonie dans les anciennes théories du style », p. 367-379.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Au rythme du Tasse », p. 381-390.
- José Kany-Turpin, Université de Paris 12 (latin) : « Le rythme selon Lucrèce : de la culture au cosmos», p. 391-402.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle (latin) : « Le rythme dans la poésie latine », p. 403-408.
- Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, membre senior honoraire, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature classique, histoire de la pensée médicale) : « Musique et folie. Histoire de rythme », p. 409-421.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
XIX. L'Origine.

- Titre
- XIX. L'Origine.
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2015
- Description
-
Nous sommes écartelés, un pied dans l'originaire, l'autre dans un temps qui se retire inéluctablement. L'idée d'origine n'est-elle qu'un mythe et sa sensation un leurre ? à quoi servent la remontée au principe et la déconnexion de l'ici-maintenant qu'elle opère ? Si l'origine libère du commencement, on s'aperçoit des équivoques auxquelles elle conduit, telles que l'idolâtrie du prétendu fondement, «l'obsession embryogénique» ou la quête naïve de «précurseurs».
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"De la prise de conscience des rythmes poétiques qui nous dirigent et de notre aptitude à les modifier plus ou moins, nous en sommes venus à la question de l’origine : pourquoi et comment un retour en arrière est-il nécessaire ? « On tient la source, l’origine, quand on a trouvé une définition et qui soit considérée comme telle dans l’histoire ». Il faut se garder de toute interprétation intempestive et partir d’une « définition paratactique », comme l’appelle Jackie. Ainsi nous faut-il poser simultanément un certain état de la bile noire et un comportement, sans préjuger de liens de cause à effet. Comment traduire 'phobia' et 'disthymia' dans le "Corpus hippocratique", VI, 23 : « Si la 'phobia' et la 'disthymia' durent longtemps, un tel état a affaire à la bile noire. » ? Ne faisons pas trop vite de 'phobia' et 'disthymia' des passions de l’âme, telles que crainte et tristesse. Tenons-les, au contraire, pour de simples comportements, tels que « retrait » et « abattement », en nous situant avant la fameuse bipartition entre passions de l’âme et maladies du corps.
L’avantage qu’on trouve à en revenir à l’origine en développant une pensée en amont, c’est de comprendre à la fois la spécificité et l’arbitraire des voies historiquement suivies. Pareille poétique se fonde sur une philosophie qui tient compte des passages et du renversement possible des extrêmes l’un dans l’autre et de la coïncidence des opposés, à la manière de Nicolas de Cues. Même si nos Entretiens ont continué à privilégier dans leurs titres un terme unique, souvent pris à la fois au singulier et au pluriel, la présence des couples de contraires y est devenue de plus en plus sensible. De fait, l’éveil suppose le sommeil, l’intérieur s’abouche à l’extérieur, et la connaissance de soi se relie à un sentiment viscéral de soi. Et, de l’autre côté, l’extérieur, le sommeil, la sensation viscérale – termes souvent oubliés, méconnus ou refoulés – se renversent également dans l’intérieur, l’éveil, la connaissance de soi. Il s’agit d’un jeu de forces qui ne cesse de se recomposer. "
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.170"| - Format
-
- 416 pages
- 22 interventions
_________________ -
Philosophie et Musique
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « L'origine n'est pas le commencement », p. 15-28.
- Marianne Massin, Université de Paris IV-Sorbonne (philosophie) : « L’origine inassignable. La recréation continuée », p. 29-39.
- José Kany-Turpin, professeur émérite, Université de Paris 12 (latin) : « Notre ‘fin’ identifiée au berceau ? Le principe originaire de l’éthique d’après les "Fins des biens et des maux", p. 41-50.
- Jean Dhombres, Centre KOYRE, EHEES, Paris (histoire de mathématiques) : « Dévoiler les origines : un paradoxe pour les mathématiques », p. 51-75.
- Jacques Athanase Gilbert, Université de Nantes (littérature comparée) : « L’énigme du commencement chez Jean-Jacques Rousseau au regard d’Augustin », p. 77-87.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « Querelles philosophiques sur l’origine de la musique : Rameau, Rousseau, d’Alembert », p. 89-111.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie – histoire de l’art) : « Remonter au Déluge : Rousseau en habit arménien », p. 113-130.
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France (membre junior honoraire), Université de Nantes, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « L’origine comme principe tautologique ? », p. 131-141.
_________________
Art et Littérature
_________________
- Romain Pigeaud, Institut de paléontologie (chercheur associé), directeur éditorial d’Errance (Actes Sud) : « L'origine de l'art et de la culture », p. 145-186.
- Etienne Wolff, Université de Paris 10 Nanterre (latin) : « L'origine de la merveille médiévale de la statue suspendue », p. 187-195.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV Sorbonne (histoire de l’art contemporain) : « Esthétique kaléidoscopique et origine », p. 197-226.
- Clélia Nau, Université de Paris 8 (philosophie) : « L’écho de l’origine. "Narcissus redivivus" de Nicolas Poussin à Cy Twombly », p. 227-251.
- Pierre Henri Frangne, Université de Rennes (philosophie) : « Origine du paysage, paysage de l’origine : peinture et photographie », p. 253-269.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Traumas, rêves, images. Scènes du crime (en histoire) et de l’origine (au cinéma), p. 271-291.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « Lever de rideau sur la pièce "Yerma" de Federico García Lorca : ou l’art dramatique achevé du dévoilement du conflit originel », p. 293-305.
_________________
Histoire et Politique
_________________
- François Clément, Université de Nantes (littérature arabe) ; CRHIA (EA 1163, Nantes) ; CESCM (UMR CNRS 6223, Poitiers) : « Sâ‘id l'Andalou et l'origine des nations », p. 309-318.
- Nicole Dhombres, historienne : « 1651, "Leviathan. Let us make man...”, p. 319-329.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « Nicolas-Antoine Boulanger et l’origine du despotisme asiatique », p. 331-350.
_________________
Poésie et Poétique
_________________
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (esthétique) : « L’aède autodidacte et l’origine de l’originalité poétique », p. 353-364.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris 3-Sorbonne nouvelle (littérature latine) : « Aux origines du poème – quelques remarques sur les conceptions de Virgile », p.365-371.
- Françoise Graziani, Université de Corte (philosophie) : « L’origine du nom de poète selon Boccace», p. 373-386.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Retour à Ossian », p. 387-394.
Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, membre senior honoraire, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature classique, histoire de la pensée médicale) : « L’origine de la mélancolie », p. 395-414
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, du conseil général de Loire-Atlantique, du conseil régional des Pays-de-la-Loire, et de la mairie de Nantes.
XX. L'Intérieur

- Titre
- XX. L'Intérieur
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2017
- Description
-
Force est de constater le basculement ou la réversion qui font passer de l'intérieur à l'extérieur et inversement. Jusqu'à quel point le dedans peut-il absorber le dehors en l'intraversant, et le dehors avoir raison du dedans en l'extraversant ? L'intérieur le plus intérieur, est-ce Dieu ou le diable ? Est-ce un principe transcendant à l'homme ou bien l'être humain comme tel ? Et quels rapports l'intérieur entretient-il avec les vicissitudes de l'histoire ?
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
Pour les Entretiens XX; XXI; XXII :
"Pour étudier ces passages, ces renversements, ces réversions, nous disposons dans le cadre des "Entretiens", d’un dernier texte élaboré et revu par Jackie Pigeaud pour "L’Intérieur", et de notes utilisées pour l’exposé oral de "L’Eveil", auxquels nous avons ajouté les quelques lignes conçues pour "La connaissance de soi" et des extraits de textes antérieurs. Je m’abstiendrai ici du commentaire direct de ces derniers textes, encore que persuadée de l’importance de l’appel à d’Aubigné que recèle, par exemple, l’Eveil. « Comme un nageur venant du profond de son plonge / Tous sortent de la mort comme l’on sort d’un songe. » La mort ne serait-elle qu’un plongeon abyssal et ressemblerait-elle à un songe dont on pourrait escompter revenir ?
« La viscéralité, le sentiment de soi » est le dernier article publié dans "Les Entretiens". Impossible de ne pas reconnaître sa portée testamentaire.
"Je tourne autour, depuis longtemps, d’un sujet terrible, mais que je crois essentiel pour l’histoire de l’imaginaire culturel. Il s’agit ni plus ni moins que d’introduire l’individu dans cette histoire ; je veux dire l’individu vivant, avec sa sensation d’être vivant, la prise de connaissance de lui-même dans son individualité, son intimité, le sentiment de soi."
Jackie Pigeaud revient une nouvelle fois sur sa traduction des vers d’Eschyle dans lesquels le chœur exprime son épouvante quand Agamemnon, revenu de Troyes, rentre dans son palais : la 'kardia', les 'phrène's, le 'thymos', les entrailles ('splagchna'), le cœur ('kêr') font entendre, chacun, leurs voix dans une cacophonie épouvantable. Tant d’organes différents auraient-ils le droit de s’exprimer en nous ? Mêmes les bijoux de famille de Diderot sont laissés en arrière !
Jackie en arrive alors à la cénesthésie (ou caenesthésie). Je me rappelle mon étonnement à seize ans, en Terminale, quand j’ai rencontré chez Merleau-Ponty ce mot qui disait l’union secrète de sensations en les rapportant à un soi énigmatique. Légèreté, plasticité, élévation, éclat, ou, au contraire, 'aphanisis', confusion, etc. Jackie Pigeaud nous apprend que le terme de cénesthésie est dû à Hübner, un élève de Reil à Halle, et apparaît dans sa thèse de 1794 pour désigner une sorte de « sixième sens », un « sens autonome, irréductible à la somme de tous les autres et qui nous renseigne, sur un mode agréable ou désagréable, sur l’existence de notre corps », pour reprendre les termes de Jackie. Ce sentiment serait faible dans l’état de santé et, au contraire, très puissant dans les maladies, contre lesquelles il nous enseignerait à lutter.
Quels rapports établir entre le chaos des informations sensorielles et la conscience globale d’un soi ? Jackie prétend donner la voix aux véritables intéressés, à ceux qui sont oubliés, aux souffrants. Sa lassitude s’exprime soudain devant ces écrits savants. « Il manque » quelque chose ou plutôt « quelqu’un dans ces recherches : "c’est le patient" ». De même qu’il ne faut pas réduire les « histoires » des patients à de simples cas ; de même, il ne faut pas que la présumée cénesthésie masque « le questionnement angoissant sur [notre] propre souffrance interne ». Traiter de la mélancolie, pour Jackie, c’est toujours traiter d’un ressenti, dans lequel se recroisent l’imaginaire culturel et le malaise le plus intime. Si la mélancolie diffère des autres maladies, c’est qu’elle soulève drastiquement le problème du rapport entre la souffrance et son sens, entre le monisme et le dualisme, entre l’être un et l’être deux. Comment pouvons-nous non pas avoir à la fois une âme et un corps, mais être à la fois l’un et l’autre ? Force est de constater que notre corps est poète et que la mélancolie nous renvoie aux racines mêmes du processus de création. « Vivre est un acte poétique ».
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.170-171"| - Format
-
- 402 pages
- 21 interventions -
_________________
Dieu, le diable et l’homme
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « L’homme intérieur et le désir du dedans », p. 17-28.
- Jacques Athanase Gilbert, Université de Nantes (littérature comparée) : « L’exposition de l’intime : l’intérieur réversé », p. 29-41.
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France (membre junior honoraire), Université de Nantes, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « Les avanies de la 'kalêpsis' : Lipse et le passage de la contemplation à l’action », p. 43-56.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Le Diable en l’homme », p. 57-66.
- Françoise Graziani, Université de Corte (philosophie) : « 'Est Deus in nobis' ; inspiration et conscience poétique », p. 67-78.
_________________
Formules, images, statuts
_________________
- Jean Dhombres, Centre Koyré, EHESS, Paris (histoire des mathématiques) : « Une formule n’est-elle qu’une forme sans intérieur ? », p. 81-106.
- Arnaud Maillet, Université de Paris 4 Sorbonne (histoire de l’art contemporain) : « 'Ut matrix camera obscura'. Entre optique et embryologie, la formation de l’image au sein de la chambre obscure (XVIe–XIXe siècles) », p. 107-167.
- François Clément, Université de Nantes, CRHIA, Nantes, CESCM, Poitiers (arabe) : « Comment être dedans quand on est dehors. Les anciens Arabes et la science selon les "Ṭabaqāt al umam" de Ṣācid l’Andalou », p. 169-183.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « L’aristocrate comme figure de l’ennemi de l’intérieur », p. 185-208.
_________________
Figures de l’intérieur dans les différents arts
_________________
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « 'Diabolus in musica' », p. 211-229.
- Yolaine Escande, CRAL, CNRS-EHESS, Paris (littérature chinoise) : « ‘Puiser aux sources de son cœur’: Intérieur et intériorité dans les arts chinois », p. 231-243.
- Clélia Nau, Université de Paris 8 (philosophie) : « L’aquarium, le fruit creux, la chambre – Monet, Bosch, Kubrick », p. 245-281.
- Céline Flécheux, université de Paris 7 (histoire de l’art) : « La Petite danseuse de 14 ans d’Edgar Degas depuis l’intérieur de sa vitrine de verre », p. 283-294.
- Romain Pigeaud, Institut de Paléontologie humaine , UMR 6566 « CReAAH », Université de Rennes (chercheur associé) : « Il faudra bien ressortir ! La grotte, passage obscur, intérieur nuit », p. 295-315.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « Autoportrait hors-sujet », p. 317-328.
_________________
Le sentiment de soi, l’image de soi
_________________
- Jackie Pigeaud, Institut Universitaire de France, membre senior honoraire, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature classique, histoire de la pensée médicale) : « La viscéralité – Le sentiment de soi-même », p. 331-344.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (esthétique) : « L’intérieur dans le style épistolaire: la lettre comme 'imago animi' », p. 345-357.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle (littérature latine): « Le souffle intérieur, spiritus intus alit », p. 359-363.
- Etienne Wolff, Université de Paris 10 Nanterre (latin) : « Intérieur et extérieur : le thème de l’hypocrisie et de la dissimulation dans quelques poèmes de l’Anthologie latine d’époque vandale », p. 365-375.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « Prélude au voyage initiatique de Federico García Lorca 'Poète à New York' : ou dans les coulisses secrètes de l'homme intérieur », p. 377-391.
_________________
Conclusion
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : Retour sur un parcours, p. 393-398.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique, Le conseil régional des Pays de la Loire.
XXI. Éveil
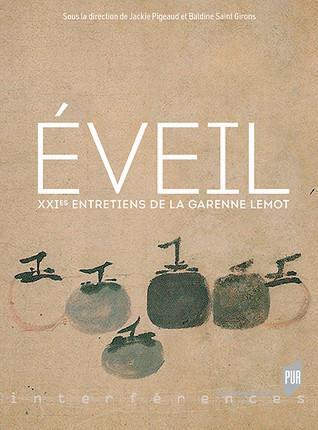
- Titre
- XXI. Éveil
- Type
- Actes de colloque
- Créateur
- Association de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2019
- Description
-
L'éveil renvoie à la naissance dont il renouvelle et banalise le miracle. Il s'oppose au sommeil ou plutôt à l'endormissement, pris comme retrait dans un monde intérieur et anticipation de la mort. Mais qu'y a-t-il de commun entre l'éveil physiologique propre à tous les animaux, et l'éveil spirituel réservé à quelques élus, en passant par toutes sortes d'éveils spécifiques qui touchent la sensibilité, l'imagination, l'intelligence, la créativité ?
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
Pour les Entretiens XX, XXI et XXII :
_________________
"Pour étudier ces passages, ces renversements, ces réversions, nous disposons dans le cadre des "Entretiens", d’un dernier texte élaboré et revu par Jackie Pigeaud pour "L’Intérieur", et de notes utilisées pour l’exposé oral de "L’Eveil", auxquels nous avons ajouté les quelques lignes conçues pour "La connaissance de soi" et des extraits de textes antérieurs. Je m’abstiendrai ici du commentaire direct de ces derniers textes, encore que persuadée de l’importance de l’appel à d’Aubigné que recèle, par exemple, l’Eveil. « Comme un nageur venant du profond de son plonge / Tous sortent de la mort comme l’on sort d’un songe. » La mort ne serait-elle qu’un plongeon abyssal et ressemblerait-elle à un songe dont on pourrait escompter revenir ?
« La viscéralité, le sentiment de soi » est le dernier article publié dans "Les Entretiens". Impossible de ne pas reconnaître sa portée testamentaire.
"Je tourne autour, depuis longtemps, d’un sujet terrible, mais que je crois essentiel pour l’histoire de l’imaginaire culturel. Il s’agit ni plus ni moins que d’introduire l’individu dans cette histoire ; je veux dire l’individu vivant, avec sa sensation d’être vivant, la prise de connaissance de lui-même dans son individualité, son intimité, le sentiment de soi."
Jackie Pigeaud revient une nouvelle fois sur sa traduction des vers d’Eschyle dans lesquels le chœur exprime son épouvante quand Agamemnon, revenu de Troyes, rentre dans son palais : la 'kardia', les 'phrène's, le 'thymos', les entrailles ('splagchna'), le cœur ('kêr') font entendre, chacun, leurs voix dans une cacophonie épouvantable. Tant d’organes différents auraient-ils le droit de s’exprimer en nous ? Mêmes les bijoux de famille de Diderot sont laissés en arrière !
Jackie en arrive alors à la cénesthésie (ou caenesthésie). Je me rappelle mon étonnement à seize ans, en Terminale, quand j’ai rencontré chez Merleau-Ponty ce mot qui disait l’union secrète de sensations en les rapportant à un soi énigmatique. Légèreté, plasticité, élévation, éclat, ou, au contraire, 'aphanisis', confusion, etc. Jackie Pigeaud nous apprend que le terme de cénesthésie est dû à Hübner, un élève de Reil à Halle, et apparaît dans sa thèse de 1794 pour désigner une sorte de « sixième sens », un « sens autonome, irréductible à la somme de tous les autres et qui nous renseigne, sur un mode agréable ou désagréable, sur l’existence de notre corps », pour reprendre les termes de Jackie. Ce sentiment serait faible dans l’état de santé et, au contraire, très puissant dans les maladies, contre lesquelles il nous enseignerait à lutter.
Quels rapports établir entre le chaos des informations sensorielles et la conscience globale d’un soi ? Jackie prétend donner la voix aux véritables intéressés, à ceux qui sont oubliés, aux souffrants. Sa lassitude s’exprime soudain devant ces écrits savants. « Il manque » quelque chose ou plutôt « quelqu’un dans ces recherches : "c’est le patient" ». De même qu’il ne faut pas réduire les « histoires » des patients à de simples cas ; de même, il ne faut pas que la présumée cénesthésie masque « le questionnement angoissant sur [notre] propre souffrance interne ». Traiter de la mélancolie, pour Jackie, c’est toujours traiter d’un ressenti, dans lequel se recroisent l’imaginaire culturel et le malaise le plus intime. Si la mélancolie diffère des autres maladies, c’est qu’elle soulève drastiquement le problème du rapport entre la souffrance et son sens, entre le monisme et le dualisme, entre l’être un et l’être deux. Comment pouvons-nous non pas avoir à la fois une âme et un corps, mais être à la fois l’un et l’autre ? Force est de constater que notre corps est poète et que la mélancolie nous renvoie aux racines mêmes du processus de création. « Vivre est un acte poétique»."
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.170-172"|
- Format
-
- 394 pages
- 22 interventions
_________________ -
- In memoriam Edouard Pommier, p. 11
- Baldine Saint Girons, Institut Universitaire de France (membre senior), professeur émérite de l’Université de Paris X-Nanterre, (philosophie) : Présentation, p. 13-19.
_________________
Première partie – Définitions : inspiration, seuil, entre-deux
_________________
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin) : « L’éveil de la Muse », p. 23-29.
- Yolaine Escande, CNRS-EHESS, Paris (spécialiste de la Chine) : « Éveil et peinture en Chine », p. 31—41.
- Romain Pigeaud, docteur, chercheur associé, UMR 6566-CReAAH du CNRS, université de Rennes &, CRAL – UMR 8566 EHESS/CNRS (préhistoire – art pariétal) : « L'éveil des sens : physiologie et sexualité dans l'art des cavernes européen », p. 43-63.
- Etienne Wolff, Université de Paris X-Nanterre, UMR 7041 ArScAn, Institut Universitaire de France (latin) : « Éveiller à la sagesse : les "Disticha Catonis" », p. 57-79.
- Patrick Dandrey, Université de Paris IV-Sorbonne (littérature française XVIIe siècle) : « Agnès au bois dormant : un éveil comique (sur "L’École des femmes" de Molière) », p. 81-92.
_________________
Deuxième partie – Musique : mélancolie et jouissance du temps
_________________
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (philosophie) : « L’aube naît et ta porte est close. Le 'paraklausíthyron' et l’éveil de sa belle », p. 95-106.
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) ; « La musique et le sommeil », p. 107-130.
- Bernardino Fantini, Université de Genève, Centre Jeantet d’histoire de la médecine : « ‘La musique éveille le temps’ » : la forme musicale comme métaphore de la vie », p. 131-164.
- Pierre Maréchaux, Institut Universitaire de France, Membre correspondant de l’IEA Nantes, Université de Nantes (littérature latine) : « L’éveil entre programme et glose : de la musique comme 'expédient' de la signification (ou de la signification comme 'expédient' de la musique) : Ravel, Schumann, Albeniz », p. 165-177.
_________________
Troisième partie – Arts plastiques : onirisme, inertie, abstraction
_________________
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « Sur un dessin de Michel-Ange : "Le Songe de la vie humaine" », p. 181-189.
- Clélia Nau, Université de Paris VII (philosophie) : « 'Vorrei che fousse l’aurora'. Éveil et torpeur dans "La Naissance de Bacchus" de Poussin », p. 191-215.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV Sorbonne Lettres (histoire de l’art contemporain) : « Eveil et réveillon dans la théorie de la pratique picturale au XVIIIe siècle », p. 217-244.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - École supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie) : « Combien ai-je dormi ? », p. 245-264.
- Céline Flécheux, Université de Paris VII (histoire de l’art) : « Tête, socle et plateau : les conditions de l’éveil chez Brancusi », p. 265-282.
- Quatrième partie – Mythe, science, littérature : métamorphose et résurrection
Jean-Luc Le Quellec, CNRS – Institut des Mondes africains (ethnologie, anthropologie, préhistoire) : « Éveil, sommeil et mort », p. 285-297.
- Jacques A. Gilbert, Université de Nantes (littérature comparée) : « L'éveil de l’axiome de l’intérêt : du 'potlatch' à l’échange individualisé », p. 299-313.
- Yvon Le Gall, Professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « Protéger la conscience en éveil », p.315-342.
- Jackie Pigeaud, Membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : « Éveil – Résurrection – Agrippa d’Aubigné (1552-1630) », p. 343-352.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « Miguel de Cervantes et la ‘mélancolique’ mort de Don Quichotte : réflexion autour du passage initiatique de la ‘folie’ du héros à son ‘éveil’ raisonné-raisonnable, p. 353-369.
_________________
Conclusion
_________________
- Baldine Saint Girons, Membre senior de l’Institut Universitaire de France, professeur émérite de l’Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Endormi, éveillé, comment me sentir un? Rêve, rêverie, folie », p. 371-390.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'université de Nantes, le laboratoire L'Antique, le Moderne - L'AMo, la ville de Nantes, le Conseil départemental de la Loire Atlantique.
XXII. La connaissance de soi

- Titre
- XXII. La connaissance de soi
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2020
- Description
-
Le retour sur soi est-il mortifère comme chez Narcisse ou bien peut-il constituer un instrument de salut et sous quelles conditions ? Peut-on faire coïncider le soi vu de l'extérieur «comme un autre», et le soi «senti», éprouvé de l'intérieur, pas vraiment «comme un autre» ? Se connaître soi-même, est-ce se connaître ou bien, loin de toute crispation identitaire, connaître tout court, co-naître à soi, aux autres et au monde, s'y entrelacer ?
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"Pour conclure : les Entretiens XXII sur "La connaissance de soi", conçus comme acmè de l’entreprise
Impossible si l’on suit la dynamique interne des vingt-deux "Entretiens" à travers les contributions de Jackie Pigeaud, de ne pas être frappé par l’étendue et la puissance de son investissement. Et cela non seulement dans chaque "Entretien", mais dans l’élaboration de leur tout-ensemble à travers plusieurs sortes d’anticipations et de reprises. Rien de plus travaillé que ce déploiement d’échos. Mais on ne s’en étonnera jamais assez : Jackie Pigeaud n’est pas seulement un philologue et un historien, pas seulement un philosophe et un poète. On ne peut pas morceler Jackie Pigeaud : c’est l’articulation de tous ces talents et de toutes ces compétences qui fait son génie propre, tendu sans cesse vers la création.
Je voudrais, pour conclure, revenir sur la téléologie de nos Entretiens. En se terminant avec "La connaissance de soi" – un sujet auquel Jackie Pigeaud nous a montré qu’il tenait singulièrement – avait-il le sentiment d’achever un cycle ? J’ai cité en introduction la confidence de Winckelmann, se disant contraint au dépassement des limites qu’il s’était assignées, et avouant sa volonté de suivre le destin des œuvres d’art "aussi loin que portait [sa] vue", telle Ariane, 'prospectans', tendue, le corps arqué, vers la voile de Thésée qui disparaît à l’horizon. Notre désir n’atteint jamais que les ombres de ses objets. Nous sommes tendus vers un « antique » qui n’est plus, qui a perdu la consistance de l’être et qui ne l’a peut-être jamais eu, mais auquel la force de notre désir assure pourtant une présence.
Jackie Pigeaud nous dirigeait-il ainsi vers une anthropologie du sujet désirant ? Il se gardait en tout cas de toute systématique. Descartes écrivait « De Dieu. Qu’il existe ». Jackie aurait pu écrire « Des problèmes, qu’ils existent ».
Le goût de la poésie et de la philosophie se partageaient son cœur. D’un côté, l’enchantement de la 'galènè' et la cruauté tragique ; de l’autre, la confiance dans la lucidité et un idéalisme impénitent. Pourquoi l’épicurisme, celui que Jackie attribue à Winckelmann, sinon parce qu’Epicure favorise si bien la poésie, est si profond philosophe qu’il en devient poète ? Pourquoi l’insistance sur la "Poétique" d’Aristote sinon parce qu’il nous faut une théorie de la production et de la reproduction ? Mais ne faut-il pas choisir entre cauchemar du rêve et cauchemar du réel ? De l’un, on s’éveille, rassuré ; de l’autre, on préférerait ne pas s’éveiller, à l’instar d’Agavé brandissant la tête de son fils, d’Hercule furieux ayant tué ses enfants ou d’Attis privé de sa virilité. Il y a dans le réel quelque chose de plus contraignant encore que le rêve. Finalement nous avons besoin des « ombres des objets de nos désirs » pour lutter contre des objets qui se montreraient sans cela écrasants.
Dans sa Préface aux "Bacchantes", Jackie se demande avec Wilamowitz « comment un homme, tel qu’Euripide, entendons un philosophe, avec une telle orientation d’esprit, pouvait devenir auteur dramatique ». Voici la réponse qu’il donne : « Un poète est d’autant plus convaincant, dirai-je, qu’il fera plus beau l’oiseau, plus chatoyant le ciel, plus nourrissante la terre. Et il fera plus captieuses les "Bacchantes", s’il leur donne le plus beau chant. On pourrait dire, dans notre perspective, qu’il sera d’autant meilleur philosophe qu’il sera meilleur poète . » Création poétique et philosophie ('largo sensu', au sens antique), telle est sans doute pour Jackie Pigeaud l’alliance des plus désirables.
Le résultat est en tout cas là : marqués depuis le commencement jusqu’à la fin du sceau du génie de Jackie Pigeaud, les "Entretiens" de la Garenne-Lemot constituent un guide de la culture vivante – vue de l’intérieur –, une bibliothèque originale aux partis pris assumés, et même une anthologie, attestant des goûts déterminés. Mieux : à la différence d’une encyclopédie qui viserait l’exhaustivité objective et dresserait un état des lieux en utilisant les commodités de l’ordre alphabétique, nos "Entretiens" ont réussi à suivre une dynamique inventive à laquelle chacun d’entre nous a contribué. L’érudition est essentielle, mais une érudition toujours conçue comme moyen, non comme fin en soi. S’il s’agit de sélectionner des éléments cardinaux d’une culture, c’est d’abord pour en goûter la saveur esthétique et en restituer la dimension créatrice. L’affirmation d’un goût ne va pas sans la reconnaissance d’un héritage ni la volonté d’en transmettre l’âpreté.
Pourquoi Jackie Pigeaud passait-il tant de temps à traduire ? C’est, écrit-il, par souci de nous restituer, de nous « faire passer » une part de cet inconscient culturel que constitue finalement l’Antique. Mais, dans cette perspective, il ne s’agit pas seulement de démonter des mécanismes. Le problème est de comprendre des flux, des « fluidités », des courants. S’il importe de sauter au-dessus des barrières inter- et intra-disciplinaires, c’est pour saisir en mouvement le rôle de l’Antique dans la formation des arts et des sciences et, à travers eux, des diverses manières inventées par l’homme pour se débrouiller avec le malaise qui lui est inhérent. Faire sortir de l’oubli les véritables « lieux communs de notre imagination culturelle » – que Jackie Pigeaud appelle non sans humour des « petites choses élémentaires » – nous permet de mieux exister, de mieux vivre, en nous installant dans le monde imaginaire auquel nous appartenons, 'nolentes, volentes'.
"Toute culture a son inconscient qui la fait vivre, rêver, se réjouir, souffrir, qu’elle soit écrite ou orale. Qui la fait exister, en somme. […] Nous ne sommes plus au temps des grandes synthèses, ni, hélas, de la mastication privée, à la façon de Montaigne. Il nous faut trouver des petites choses élémentaires qui nous refassent habitants de ce monde imaginaire ."
(Jackie Pigeaud, "Melancholia", p.18-19)
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.172"|
- Format
-
- 414 pages
- 20 interventions -
- Baldine Saint Girons, Membre senior de l’Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : Présentation, p. 11-21.
- Jackie Pigeaud, Membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : Ouverture, p. 23-28.
_________________
I. Leçons du mythe et de la poésie antique : l’image de soi entre illusion, artifice et révélation
Françoise Graziani, Université de Corte (philosophie) : « ‘Il vivra s'il ne se connaît pas’ : le Narcisse d'Ovide », p. 29-47
_________________
- Clélia Nau, Université de Paris VII (philosophie) : « Narcisse au miroir d'inconnaissance », p. 49-78.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin) : « Horace se découvre ("Satire" II, 7) », p. 81-86.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (esthétique) : « La connaissance de soi et l’expérience de l’'excessus mentis' : Plotin et Dante », p. 87-97.
_________________
II. Vers les sciences de l’homme : certitudes et impasses de la connaissance de soi
Adelino Cardoso, Centro de Historia da cultura, Université de Lisbonne (philosophie) : « Le 'cogito' comme sentiment confus de soi chez Malebranche », p. 101-111.
_________________
- Baldine Saint Girons, Membre senior de l’Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Se connaître ou se sentir ? La naissance des sciences de l’homme », p.113-130.
- Jacques Athanase Gilbert, Université de Nantes (littérature comparée) : « Qui est le soi qu’on connaît ? », p. 131-149.
_________________
III. Mises en son et mises en scène : méconnaissance, reconnaissance et expérimentation
_________________
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « Reconnaissance, péripétie et déviation tonale dans la théorie du drame lyrique entre 1580 et 1630 », p. 153-178.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie) : « ‘Je me vis dans la glace et je me fis presque peur’ », p. 179-191.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV Sorbonne Lettres, centre André Chastel - UMR 8150 (histoire de l’art contemporain) : « La palette, instrument de la connaissance de soi ? Théorie de la pratique picturale », p. 193-211.
- Irley Machado, professeur à l’Université Fédérale d’Uberlândia - UFU, Directrice de la Culture, Brésil (théâtre et littérature) : « Le théâtre à la source de la connaissance de soi ? », p. 213-223.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « "And the self, pure, classical, was something broken off again" : Memoire, monument, modernité », p. 225-236.
_________________
IV. Fictions poétiques et romanesques : vicissitudes de l’identification et de la désidentification
_________________
- Pierre Maréchaux, université de Nantes, Institut universitaire de France, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « "Les universaux de la singularité: Rudaki et les stratégies synesthésiques », p. 239-261.
- François Clément, université de Nantes, CRHIA (EA 1163), Nantes, CESCM (UMR CNRS 7302, Poitiers (litératuez arabe) : « Erreur et délivrance, ou le retour sur soi d’Al-Ġazālī », P. 263-276.
- Jocelyne Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « ‘Mon Premier Amour’ de Federico García Lorca », p. 277-307.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « L'atelier et l'armoire comme lieux de connaissance de soi : Claude Louis-Combet et Jean-Paul Goux », p. 309-334.
_________________
V. Connaissance ou co-naissance ? De la productivité mathématique à la reconstitution de l’homme préhistorique
_________________
- Jean Dhombres, directeur d’études, Centre Koyré, EHESS, Paris, (histoire des mathématiques) : « Connaît-on vraiment ce que l’on tire de soi ? L’apprivoisement des mondes mathématiques par Turing, Pascal, Weyl, ou Weil », p. 337-362.
- Romain Pigeaud, docteur, chercheur associé UMR 6566 – CReAAH du CNRS université de Rennes 1, CRAL-UMR 8566 EHESS/CNRS (pré »histoire – art pariétal) : « Préhistoire et transgression : à propos d'une idée de Georges Bataille », p. 363-385.
- Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche émérite au CNRS – UMR 8171 (anthropologie, préhistoire) : « Connaissance de soi au Paléolithique », p. 387-397.
_________________
Conclusion : Une identité toujours à reconquérir
_________________
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « L’Apprentissage de soi – Sur une nouvelle d’Antonio Manetti », p. 401-409.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'association Les entretiens de la Garenne Lemot, du laboratoire «L'antique, Le Moderne - L'AMo de l'université de Nantes, du conseil départemental de Loire-Atlantique et de la mairie de Nantes.
XXIII. Savoir et Création, autour de l’œuvre de Jackie Pigeaud.
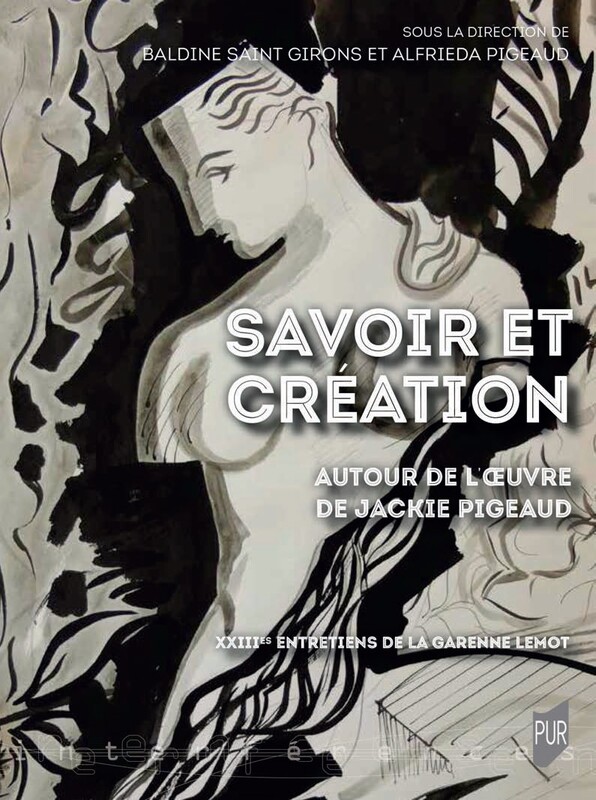
- Titre
- XXIII. Savoir et Création, autour de l’œuvre de Jackie Pigeaud.
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2022
- Description
-
" La grande aventure des Entretiens de La Garenne Lemot autour de L'héritage gréco-latin se termine aujourd'hui avec sa XXIIIe livraison. Jackie Pigeaud est décédé, mais le présent ouvrage témoigne partout de sa présence active autour de deux questions et de deux convictions. Qu'est-ce qui relie le savoir et la création ? En quel sens sommes-nous encore grecs, sommes-nous encore romains ? L'œuvre de Jackie Pigeaud et les amis chercheurs réunis autour de lui ont répondu avec la conviction selon laquelle savoir et création ne sont pas des résultats mais des modes de sublimation par lesquels nous nous dépassons. Ils ont répondu également avec l'idée selon laquelle, entre les Grecs et les Romains et nous, il n'y a pas seulement des ruptures mais des continuités qu'une philologie exigeante permet de comprendre en libérant une « science de l'imaginaire culturel » et une poétique dont l'exercice nous aide à vivre. Jackie Pigeaud écrivait : « Faut-il donc tant d'espace pour voyager ? Celui de ma bibliothèque me suffit. Je ne suis pas un explorateur. L'idée même m'en fait rire. Mais dans ma bibliothèque, je suis un aventurier, un corsaire qui aime l'abordage. » C'est à cet abordage tout pacifique - mais érudit, profond, utile - des œuvres et des aspects les plus anciens et les plus neufs de notre culture que le lecteur est ici invité."
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
- Format
-
- 446 pages
- 25 interventions -
_________________
Présentation
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut universitaire de France, professeur émérite de l’université de Paris Nanterre (philosophie) : « Jackie Pigeaud ou le gai savoir de la mélancolie », p.15-34.
Introduction
_________________
- Jean Dhombres, directeur d’études, Centre Koyré, EHESS, Paris, (histoire des sciences exactes), directeur de recherche honoraire, CNRS (mathématiques) : « Quel dialogue avec les Anciens à l’âge des algorithmes conçus pour penser et même sentir à notre place ? », p. 37-64.
Première partie
_________________
- Portraits de Jackie Pigeaud – l’union du sublime et de la mélancolie A. Jackie Pigeaud dans le miroir de sa bibliothèque
- Patrick Dandrey, (MSRC) Paris, université de la Sorbonne : « Les tiroirs de l’archiviste – Petit inventaire des passions de Jackie Pigeaud », p. 69-84.
- Françoise Graziani, – université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA (littérature comparée) : « La leçon des vieux livres – La bibliothèque de Jackie Pigeaud », p. 75-84.
- Yves Hersant, EHESS, Paris (littérature et philosophie de la Renaissance) : « Défense et illustration de la 'curiositas' », p. 85-96.
B. Figures zoologiques, géographiques et scripturaires
_________________
- Etienne Wolff, Institut universitaire de France, Université de Paris Nanterre (latin) : « Portrait paradoxal de Jackie Pigeaud en mouche », p. 99-102.
- Arnaud Maillet, Sorbonne université, faculté des Lettres, Centre André Chastel-Laboratoire de recherche en Histoire de l’art (UMR 8150) (histoire de l’art contemporain) : « 'Aranea geometrizans' : La toile d’araignée ou l’art de discerner en perspective (XVIe-XXe siècles) », p. 103-144.
- Philippe Mudry, professeur émérite de l’université de Lausanne, Suisse (latin, histoire de la médecine) : « Jackie Pigeaud : un Vendéen chez les Helvètes », p. 145-150.
- Yolaine Escande, directrice de recherche au CNRS, membre du CRAL/EHESS (arts graphiques chinois) : « Le caractère 'Mélancolie' en chinois », p. 151-152.
Deuxième Partie
Dialogue entre Anciens et Modernes : liens de parenté, appuis et relais
_________________
- Baldine Saint Girons, Institut universitaire de France, professeur émérite de l’université de Paris Nanterre (philosophie) : « Les vingt-deux Entretiens de La Garenne-Lemot et la logique de leur développement à travers les contributions de Jackie Pigeaud 1994-2016 », p. 155-176.
- Jacques-Athanase Gilbert, université de Nantes (littérature comparée) : « Sans visée – Sur l’Introduction à La Vérité des songes d’Aristote par Jackie Pigeaud », p. 177-191.
- Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeur émérite de l’université de Nantes (littérature espagnole) : « Un exemple de la technique littéraire de l’Apologie chez l’Infant Don Juan Manuel (1242-1346) : ‘l’orphelin’ et la théorie sélective de l’allaitement », p. 193-216.
- Brenno Boccadoro, université de Genève, Suisse (musicologie) : « Marsile Ficin : l’image sonore comme miroir de l’invisible », p. 217-253.
- Céline Flécheux, université de Paris CERILAC (philosophie) : « La Résurrection : idée, thème ou événement ? », p. 255-271.
- Mariana Saad, chercheur associée, IHMC, Paris (histoire de la médecine) : « Le long dix-huitième siècle de Jackie Pigeaud : à propos de "Pinel, L’Ancien et le Moderne" », p. 273-286.
- Bernardino Fantini, université de Genève, Suisse (histoire de la médecine) : « Le beau et le vrai – Savoir et création dans les sciences biologiques contemporaines », p. 287-323.
Troisième Partie
Une science de l’imaginaire culturel : Philologie décapante et rêverie instruite
_________________
- Frédéric Le Blay, Université de Nantes, Centre François Viète (langues & littératures anciennes, philosophie des sciences) : « Sur des notes de séminaire (2000-2003) – Jackie Pigeaud, historien de la culture », p. 327-341.
- Pierre Maréchaux, Institut universitaire de France, université de Nantes, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « Le traducteur paysan : à propos du Lucrèce de Jackie Pigeaud », p. 343-364.
- Giovanni Lombardo, université de Messine, Italie (esthétique) : « Sur un livre “italien” de Jackie : "Tre fantasie sulla phantasia" –Souvenirs d’un traducteur », p. 365-372.
- François Clément, CESCM - UMR CNRS 7302-, Poitiers) (langue et civilisation arabes) : « La langue de Jackie », p. 373-381.
- Chakè Matossian, professeur honoraire de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Belgique (philosophie) : « Jackie Pigeaud à Bruxelles : "La Part de l’Œi"l et l’huître rêveuse », p. 383-390.
- Filippo Fimiani, université de Salerno, Italie (philosophie) : « ‘Tu vis et tu ne me fais rien’. D’une poïétique des images », p. 391-405.
Conclusion : Le fait poétique
_________________
- Romain Pigeaud, Docteur en préhistoire. Chercheur associé. UMR 6566 « CReAAH », université de Rennes-1. Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (UMR 8566 EHESS/CNRS) : « Du bouclier d'Achille à la rotonde de Lascaux : la grotte comme catalogue et résumé du monde paléolithique », p. 409-435.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’université Paris Sorbonne Nouvelle (latin) : « En fait, il n’y a que la poésie », p. 437-441.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'Association Les Entretiens de la Garenne Lemot, du laboratoire L'AMo (L'Antique le Moderne) de Nantes Université, du Conseil départemental de Loire Atlantique et de la Mairie de Nantes