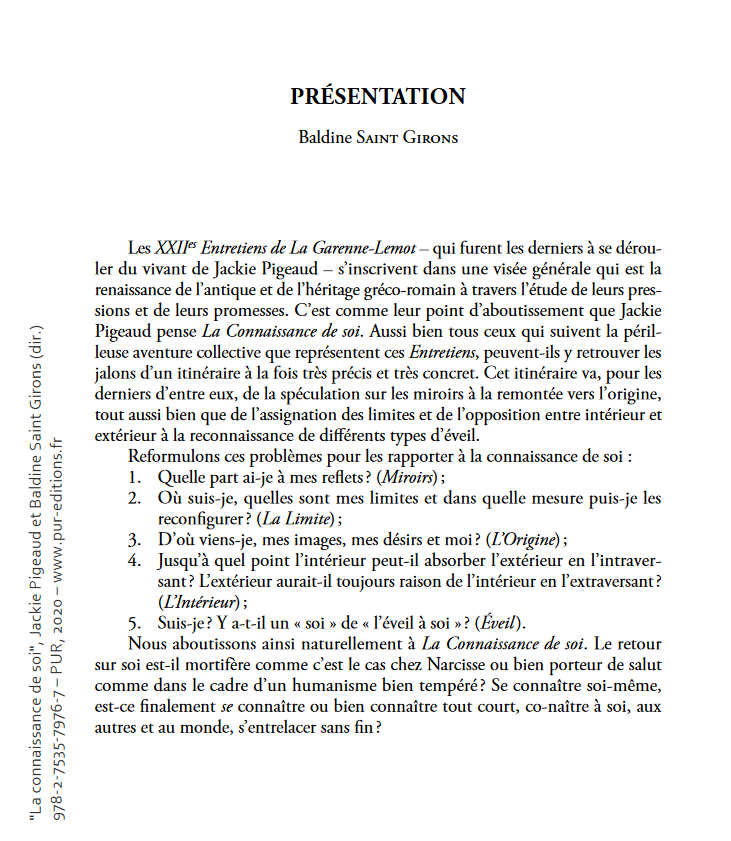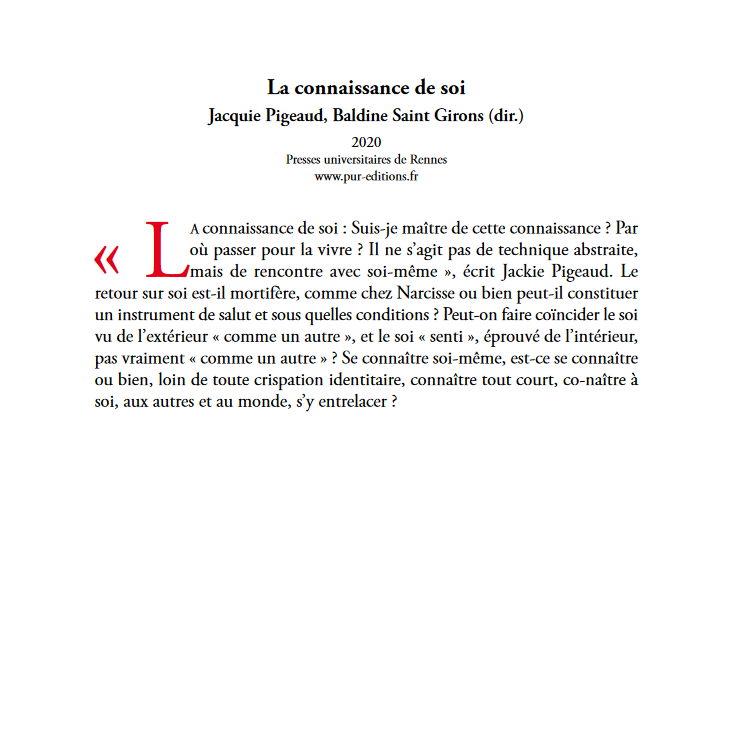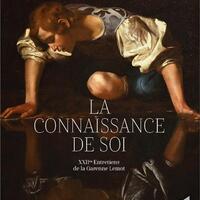XXII. La connaissance de soi
- Titre
- XXII. La connaissance de soi
- Type
- Actes du colloque
- Créateur
- Association des Entretiens de la Garenne Lemot
- Date
- Publication des Actes : 2020
- Description
-
Le retour sur soi est-il mortifère comme chez Narcisse ou bien peut-il constituer un instrument de salut et sous quelles conditions ? Peut-on faire coïncider le soi vu de l'extérieur «comme un autre», et le soi «senti», éprouvé de l'intérieur, pas vraiment «comme un autre» ? Se connaître soi-même, est-ce se connaître ou bien, loin de toute crispation identitaire, connaître tout court, co-naître à soi, aux autres et au monde, s'y entrelacer ?
_________________
Extrait de la 4ème de couverture _ Presses Universitaires de Rennes (PUR)
_________________
"Pour conclure : les Entretiens XXII sur "La connaissance de soi", conçus comme acmè de l’entreprise
Impossible si l’on suit la dynamique interne des vingt-deux "Entretiens" à travers les contributions de Jackie Pigeaud, de ne pas être frappé par l’étendue et la puissance de son investissement. Et cela non seulement dans chaque "Entretien", mais dans l’élaboration de leur tout-ensemble à travers plusieurs sortes d’anticipations et de reprises. Rien de plus travaillé que ce déploiement d’échos. Mais on ne s’en étonnera jamais assez : Jackie Pigeaud n’est pas seulement un philologue et un historien, pas seulement un philosophe et un poète. On ne peut pas morceler Jackie Pigeaud : c’est l’articulation de tous ces talents et de toutes ces compétences qui fait son génie propre, tendu sans cesse vers la création.
Je voudrais, pour conclure, revenir sur la téléologie de nos Entretiens. En se terminant avec "La connaissance de soi" – un sujet auquel Jackie Pigeaud nous a montré qu’il tenait singulièrement – avait-il le sentiment d’achever un cycle ? J’ai cité en introduction la confidence de Winckelmann, se disant contraint au dépassement des limites qu’il s’était assignées, et avouant sa volonté de suivre le destin des œuvres d’art "aussi loin que portait [sa] vue", telle Ariane, 'prospectans', tendue, le corps arqué, vers la voile de Thésée qui disparaît à l’horizon. Notre désir n’atteint jamais que les ombres de ses objets. Nous sommes tendus vers un « antique » qui n’est plus, qui a perdu la consistance de l’être et qui ne l’a peut-être jamais eu, mais auquel la force de notre désir assure pourtant une présence.
Jackie Pigeaud nous dirigeait-il ainsi vers une anthropologie du sujet désirant ? Il se gardait en tout cas de toute systématique. Descartes écrivait « De Dieu. Qu’il existe ». Jackie aurait pu écrire « Des problèmes, qu’ils existent ».
Le goût de la poésie et de la philosophie se partageaient son cœur. D’un côté, l’enchantement de la 'galènè' et la cruauté tragique ; de l’autre, la confiance dans la lucidité et un idéalisme impénitent. Pourquoi l’épicurisme, celui que Jackie attribue à Winckelmann, sinon parce qu’Epicure favorise si bien la poésie, est si profond philosophe qu’il en devient poète ? Pourquoi l’insistance sur la "Poétique" d’Aristote sinon parce qu’il nous faut une théorie de la production et de la reproduction ? Mais ne faut-il pas choisir entre cauchemar du rêve et cauchemar du réel ? De l’un, on s’éveille, rassuré ; de l’autre, on préférerait ne pas s’éveiller, à l’instar d’Agavé brandissant la tête de son fils, d’Hercule furieux ayant tué ses enfants ou d’Attis privé de sa virilité. Il y a dans le réel quelque chose de plus contraignant encore que le rêve. Finalement nous avons besoin des « ombres des objets de nos désirs » pour lutter contre des objets qui se montreraient sans cela écrasants.
Dans sa Préface aux "Bacchantes", Jackie se demande avec Wilamowitz « comment un homme, tel qu’Euripide, entendons un philosophe, avec une telle orientation d’esprit, pouvait devenir auteur dramatique ». Voici la réponse qu’il donne : « Un poète est d’autant plus convaincant, dirai-je, qu’il fera plus beau l’oiseau, plus chatoyant le ciel, plus nourrissante la terre. Et il fera plus captieuses les "Bacchantes", s’il leur donne le plus beau chant. On pourrait dire, dans notre perspective, qu’il sera d’autant meilleur philosophe qu’il sera meilleur poète . » Création poétique et philosophie ('largo sensu', au sens antique), telle est sans doute pour Jackie Pigeaud l’alliance des plus désirables.
Le résultat est en tout cas là : marqués depuis le commencement jusqu’à la fin du sceau du génie de Jackie Pigeaud, les "Entretiens" de la Garenne-Lemot constituent un guide de la culture vivante – vue de l’intérieur –, une bibliothèque originale aux partis pris assumés, et même une anthologie, attestant des goûts déterminés. Mieux : à la différence d’une encyclopédie qui viserait l’exhaustivité objective et dresserait un état des lieux en utilisant les commodités de l’ordre alphabétique, nos "Entretiens" ont réussi à suivre une dynamique inventive à laquelle chacun d’entre nous a contribué. L’érudition est essentielle, mais une érudition toujours conçue comme moyen, non comme fin en soi. S’il s’agit de sélectionner des éléments cardinaux d’une culture, c’est d’abord pour en goûter la saveur esthétique et en restituer la dimension créatrice. L’affirmation d’un goût ne va pas sans la reconnaissance d’un héritage ni la volonté d’en transmettre l’âpreté.
Pourquoi Jackie Pigeaud passait-il tant de temps à traduire ? C’est, écrit-il, par souci de nous restituer, de nous « faire passer » une part de cet inconscient culturel que constitue finalement l’Antique. Mais, dans cette perspective, il ne s’agit pas seulement de démonter des mécanismes. Le problème est de comprendre des flux, des « fluidités », des courants. S’il importe de sauter au-dessus des barrières inter- et intra-disciplinaires, c’est pour saisir en mouvement le rôle de l’Antique dans la formation des arts et des sciences et, à travers eux, des diverses manières inventées par l’homme pour se débrouiller avec le malaise qui lui est inhérent. Faire sortir de l’oubli les véritables « lieux communs de notre imagination culturelle » – que Jackie Pigeaud appelle non sans humour des « petites choses élémentaires » – nous permet de mieux exister, de mieux vivre, en nous installant dans le monde imaginaire auquel nous appartenons, 'nolentes, volentes'.
"Toute culture a son inconscient qui la fait vivre, rêver, se réjouir, souffrir, qu’elle soit écrite ou orale. Qui la fait exister, en somme. […] Nous ne sommes plus au temps des grandes synthèses, ni, hélas, de la mastication privée, à la façon de Montaigne. Il nous faut trouver des petites choses élémentaires qui nous refassent habitants de ce monde imaginaire ."
(Jackie Pigeaud, "Melancholia", p.18-19)
| Baldine Saint Girons, "Savoir et création", XXIIIe Entretiens de la Garenne Lemot, Rennes, PUR, 2022, p.172"|
- Format
-
- 414 pages
- 20 interventions -
- Baldine Saint Girons, Membre senior de l’Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : Présentation, p. 11-21.
- Jackie Pigeaud, Membre senior honoraire de l’Institut Universitaire de France, Université de Nantes (latin, histoire de la médecine) : Ouverture, p. 23-28.
_________________
I. Leçons du mythe et de la poésie antique : l’image de soi entre illusion, artifice et révélation
Françoise Graziani, Université de Corte (philosophie) : « ‘Il vivra s'il ne se connaît pas’ : le Narcisse d'Ovide », p. 29-47
_________________
- Clélia Nau, Université de Paris VII (philosophie) : « Narcisse au miroir d'inconnaissance », p. 49-78.
- Philippe Heuzé, professeur émérite de l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle (latin) : « Horace se découvre ("Satire" II, 7) », p. 81-86.
- Giovanni Lombardo, Université de Messine, Italie (esthétique) : « La connaissance de soi et l’expérience de l’'excessus mentis' : Plotin et Dante », p. 87-97.
_________________
II. Vers les sciences de l’homme : certitudes et impasses de la connaissance de soi
Adelino Cardoso, Centro de Historia da cultura, Université de Lisbonne (philosophie) : « Le 'cogito' comme sentiment confus de soi chez Malebranche », p. 101-111.
_________________
- Baldine Saint Girons, Membre senior de l’Institut Universitaire de France, Université de Paris X-Nanterre (philosophie) : « Se connaître ou se sentir ? La naissance des sciences de l’homme », p.113-130.
- Jacques Athanase Gilbert, Université de Nantes (littérature comparée) : « Qui est le soi qu’on connaît ? », p. 131-149.
_________________
III. Mises en son et mises en scène : méconnaissance, reconnaissance et expérimentation
_________________
- Brenno Boccadoro, Université de Genève (musicologie) : « Reconnaissance, péripétie et déviation tonale dans la théorie du drame lyrique entre 1580 et 1630 », p. 153-178.
- Chakè Matossian, Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts, Bruxelles (philosophie) : « ‘Je me vis dans la glace et je me fis presque peur’ », p. 179-191.
- Arnaud Maillet, Université de Paris IV Sorbonne Lettres, centre André Chastel - UMR 8150 (histoire de l’art contemporain) : « La palette, instrument de la connaissance de soi ? Théorie de la pratique picturale », p. 193-211.
- Irley Machado, professeur à l’Université Fédérale d’Uberlândia - UFU, Directrice de la Culture, Brésil (théâtre et littérature) : « Le théâtre à la source de la connaissance de soi ? », p. 213-223.
- Filippo Fimiani, Université de Salerno, Italie (philosophie) : « "And the self, pure, classical, was something broken off again" : Memoire, monument, modernité », p. 225-236.
_________________
IV. Fictions poétiques et romanesques : vicissitudes de l’identification et de la désidentification
_________________
- Pierre Maréchaux, université de Nantes, Institut universitaire de France, membre correspondant de l’IEA Nantes (littérature latine) : « "Les universaux de la singularité: Rudaki et les stratégies synesthésiques », p. 239-261.
- François Clément, université de Nantes, CRHIA (EA 1163), Nantes, CESCM (UMR CNRS 7302, Poitiers (litératuez arabe) : « Erreur et délivrance, ou le retour sur soi d’Al-Ġazālī », P. 263-276.
- Jocelyne Bourligueux, professeur émérite de l’Université de Nantes (littérature espagnole) : « ‘Mon Premier Amour’ de Federico García Lorca », p. 277-307.
- Yvon Le Gall, professeur émérite de l’Université de Nantes (droit) : « L'atelier et l'armoire comme lieux de connaissance de soi : Claude Louis-Combet et Jean-Paul Goux », p. 309-334.
_________________
V. Connaissance ou co-naissance ? De la productivité mathématique à la reconstitution de l’homme préhistorique
_________________
- Jean Dhombres, directeur d’études, Centre Koyré, EHESS, Paris, (histoire des mathématiques) : « Connaît-on vraiment ce que l’on tire de soi ? L’apprivoisement des mondes mathématiques par Turing, Pascal, Weyl, ou Weil », p. 337-362.
- Romain Pigeaud, docteur, chercheur associé UMR 6566 – CReAAH du CNRS université de Rennes 1, CRAL-UMR 8566 EHESS/CNRS (pré »histoire – art pariétal) : « Préhistoire et transgression : à propos d'une idée de Georges Bataille », p. 363-385.
- Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche émérite au CNRS – UMR 8171 (anthropologie, préhistoire) : « Connaissance de soi au Paléolithique », p. 387-397.
_________________
Conclusion : Une identité toujours à reconquérir
_________________
- Yves Hersant, EHESS, Paris (philosophie de la Renaissance) : « L’Apprentissage de soi – Sur une nouvelle d’Antonio Manetti », p. 401-409.
_________________ - Contributeur
- Avec le soutien de l'association Les entretiens de la Garenne Lemot, du laboratoire «L'antique, Le Moderne - L'AMo de l'université de Nantes, du conseil départemental de Loire-Atlantique et de la mairie de Nantes.
- Pages du site
- Consulter les Entretiens (ouvrages)
Ressources liées
Fait partie de XXII. La connaissance de soi